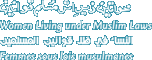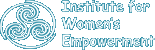Dossier 20: Les dangers du pluralisme
Date:
décembre 1997 | Attachment | Size |
|---|---|
| Word Document | 98.96 KB |
doss20/f
number of pages:
179 Croire au pluralisme et à une société multiculturelle fait tellement partie de notre vie que nous nous arrêtons à peine pour en contester certains aspects. Tout est forcément bon. Comme le dit Nathan Glazer, universitaire américain et ancien détracteur du pluralisme, dans le titre de son nouveau livre, We are All Multiculturalists Now (‘Nous sommes tous des multiculturalistes aujourd’hui’). Le culte de la différence, la défense d’une société diverse, la tolérance envers une variété d’identités culturelles : pratiquement tout le monde considère que ce sont là les signes d’une société décente, libérale, démocratique et non raciste.
J’aimerais, dans cet article, remettre en question cette thèse facile selon laquelle le pluralisme est forcément une bonne chose. Je veux plutôt montrer que l’idée du pluralisme est extrêmement ambiguë ; que l’idée de la différence a toujours été au cœur du programme, non pas antiraciste, mais raciste ; et que la société multiculturelle s’est créée aux dépens d’une société plus juste.
Rien qu’un regard rapide sur l’idée du pluralisme révèle à quel point ce concept est ambigu. Sarajevo est peut-être un symbole de multiculturalisme, mais c’est l’affirmation de la “différence” qui, au départ, a conduit à l’effondrement de la fédération yougoslave et à une guerre civile sauvage. L’extrême-droite en France a pendant longtemps adroitement exploité l’idée de la différence culturelle pour s’opposer à la possibilité qu’un musulman devienne français. La campagne du Conseil de l’Europe contre le racisme et la xénophobie a adopté un slogan – “tous égaux, tous différents”- qui, une génération auparavant, était le cri de guerre des ségrégationnistes d’Amérique du sud et des défenseurs de l’apartheid en Afrique du Sud.
Si ces exemples montrent la difficulté de tracer une frontière entre le respect de la différence et le mépris de l’Autre, alors d’après le philosophe américain, Richard Rorty, défendre le pluralisme est peut-être incompatible avec la recherche de l’égalité. Le pluralisme, dit-il, plonge ceux qu’il appelle les “libéraux éclairés” dans un dilemme terrible :
Leur libéralisme les oblige à considérer tout doute sur l’égalité entre les hommes comme le résultat d’un préjugé irrationnel. Cependant, leur connaissance [du pluralisme] les oblige à se rendre compte que la majorité des habitants du globe ne croit pas à l’égalité, qu’une telle idée est une excentricité occidentale. Vu qu’ils pensent qu’il serait scandaleusement ethnocentrique de dire : “Et alors ? Nous, les libéraux occidentaux, nous y croyons et c’est tant mieux pour nous”, ils sont coincés.
Rorty lui-même règle le problème en prétendant que l’égalité est bonne pour “nous” mais pas forcément pour “eux”. Ce qui correspond aux arguments de nombreux libéraux aujourd’hui qui veulent définir l’égalité pour l’adapter à un monde plus pluraliste. Mais lorsque le respect des autres signifie ne pas porter un jugement sur leurs valeurs et leurs normes, lorsque des habitudes arriérées, des institutions réactionnaires et des croyances illogiques sont défendues au motif qu’elles ne signifient peut-être pas grand-chose dans notre culture mais qu’elles comptent dans d’autres, alors la quête de la différence devient celle de l’indifférence, un mépris cynique envers le sort des autres au motif qu’ils “ne sont pas comme nous”. Rorty a raison de dire que le pluralisme et l’égalité ont des exigences contradictoires pour la société. La réponse, cependant, n’est pas d’abandonner notre attachement à l’égalité mais de repenser ce que nous entendons par pluralisme.
La défense de la “différence”, loin d’être un principe antiraciste, a, dès le début, été au cœur du programme raciste. Depuis le Siècle des lumières, les penseurs et décideurs occidentaux se débattent dans les contradictions des sociétés affichant une solide conviction et un profond respect pour l’égalité et qui, cependant, sont elles-mêmes profondément inégalitaires. C’est de cette contradiction que l’idéologie de la race est née. La théorie raciale a essayé d’expliquer le gouffre entre un attachement abstrait à l’égalité et la réalité de l’inégalité sociale en faisant croire que l’inégalité elle-même était naturelle. La société était inégale parce que le destin de chaque groupe était, d’une certaine façon, lié à des qualités propres à chacun. Pour les théoriciens de la race, la nature de la société se retrouve dans ses différences.
Au XIXème siècle, les différences entre les groupes étaient généralement envisagées d’un point de vue biologique –comme dans l’idéologie du racisme scientifique. Aujourd’hui, ces différences sont, plus souvent qu’il ne faut, qualifiées de culturelles. Les horreurs du nazisme et l’Holocauste ont contribué à discréditer la science raciale et les théories biologiques sur les différences humaines. Mais, si après la guerre la science raciste a été enterrée, ça n’a pas été le cas de la pensée raciste. Les arguments biologiques en faveur de la supériorité raciale sont tombés en discrédit et les manifestations ouvertes de racisme sont devenues déshonorantes. Toutes les idées de la pensée raciste, cependant, sont demeurées intactes, en particulier l’idée que l’humanité peut être séparée en groupes distincts ; que chaque groupe doit être pris dans son contexte ; que chaque groupe est d’une certaine façon incomparable aux autres ; et que les relations importantes dans la société ne proviennent pas de ce que ces groupes ont en commun mais de leurs différences. L’expression de la pensée raciste, cependant, a changé. Elle ne s’exprime plus en termes biologiques mais emprunte le vocabulaire du pluralisme culturel. Au niveau des mesures à prendre, cela a conduit à la recherche du “multiculturalisme” en tant qu’objectif social souhaitable.
La notion d’une société multiculturelle est apparue dans l’après-guerre en grande partie en réponse à l’impact de l’immigration massive dans les sociétés occidentales. Onze millions de travailleurs sont arrivés en Europe dans les années 1950 et 1960, encouragés par l’expansion économique. Aux Etats-Unis, une forme différente d’immigration de masse a eu lieu : un déplacement extrêmement important d’Africains-américains vers les villes du nord dans les années 50 et 60. Dans les deux cas, les nouveaux arrivants se sont retrouvés en marge de la société, soumis au racisme et à la discrimination, et mis dans l’incapacité de parvenir à accéder aux leviers du pouvoir. Cette idéologie multiculturaliste s’est développée comme un compromis devant la persistance des inégalités en dépit des discours sur l’intégration, l’assimilation et l’égalité.
Dans les Etats-Unis des années 60, par exemple, la plupart des commentateurs, blancs et noirs, espéraient et escomptaient que les Africains-américains en migrant vers le nord s’intégreraient finalement à la société américaine, comme ce fut le cas pour les immigrés européens. Le titre d’un article de 1966 d’Irving Kristol dans le New York Times rend bien compte de cet espoir : “Le Nègre d’aujourd’hui est comme l’immigré d’hier”. Trente ans plus tard, nous pouvons constater combien ces affirmations étaient malheureusement erronées. Pratiquement toutes les statistiques sociales –de la ségrégation pour le logement aux taux des mariages mixtes, des taux de mortalité infantile à l’utilisation de la langue – montrent que les Africains-américains ont une vie différente du reste de l’Amérique. Même la vie des Hispano-américains est plus proche de celle des américains blancs que de celle des Africains-américains.
L’échec du mouvement pour l’égalité a conduit à la célébration de la différence. La critique noire américaine Bell Hooks fait remarquer que la réforme des “droits civiques a renforcé l’idée que la libération des Noirs doit être définie en fonction de leur égalité d’accès aux chances et aux privilèges matériels avec les Blancs : emploi, logement, éducation, etc.” D’après Hooks, cette stratégie ne peut pas conduire à la libération, car ces “idées de ‘liberté’ ont été motivées par le désir d’imiter le comportement, le mode de vie et, surtout, les valeurs et les connaissances des colons blancs”. L’échec de l’égalité a conduit des critiques radicaux comme Hooks à déclarer que cette égalité elle-même est problématique car les Africains-américains sont “différents” des blancs.
Les hommes politiques et les décideurs ont répondu à ces arguments en transformant les Etats-Unis en une nation “multiculturelle”. Le multiculturalisme est fondé sur l’idée d’une nation composée de nombreux groupes et personnes culturellement différents, alors qu’il est, en fait, le résultat de l’exclusion permanente d’un groupe : les Africains-américains. Défendre le multiculturalisme, c’est reconnaître tacitement que les barrières qui séparent les Blancs des Noirs ne peuvent pas être supprimées et que l’égalité est abandonnée en tant qu’objectif de politique sociale. “Le multiculturalisme”, écrit Nathan Glazer, est le prix que l’Amérique paie pour son incapacité, ou son manque de volonté, à intégrer dans sa société les Africains-américains, de la même façon et dans la même mesure qu’elle a intégré tant d’autres groupes.” Le prix réel, cependant, est payé par les Africains-américains eux-mêmes. Car en réalité, l’Amérique n’est pas multiculturelle ; elle est simplement inégale. Et la défense du multiculturalisme est une reconnaissance de l’inéluctabilité de cette inégalité.
La “ mise à l’écart ” des Noirs et des communautés immigrées en Europe occidentale n’est probablement pas aussi grande que celle des Africains-américains aux Etats-Unis. Néanmoins, là aussi, le pluralisme est devenu un moyen d’éviter le débat sur l’échec de l’égalité. Alors que les communautés noires sont restées exclues de la société dominante, discriminées et souvent cramponnées à de vieilles habitudes et d’anciens styles de vie, comme points de repère familiers dans un monde hostile, ces différences ont été interprétées non comme le produit négatif du racisme mais comme le résultat positif du pluralisme.
Nombre de jeunes gens à Marseille ou dans la banlieue est de Londres se disent musulmans, par exemple, moins en raison d’une foi religieuse ou d’habitudes culturelles que parce qu’en présence d’une société hostile, antimusulmane, s’affirmer musulman est une façon de défendre la dignité de sa communauté. Leur Islam n’est pas la libre célébration d’une identité, mais une tentative de négocier le mieux possible une relation difficile avec une société hostile. Les musulmans à Londres ou à Paris ne choisissent pas plus leur “différence” que les jeunes africains-américains dans le Bronx ou à South Central Los Angeles –ou, d’ailleurs, les Juifs du temps de l’Allemagne nazie. Comme l’a dit un militant musulman de Bradford : “Notre Islam est construit par la force de l’hystérie antimusulmane de ce pays”. En présentant ces sociétés si fracturées comme “multiculturelles”, nous risquons de célébrer les différences que nous imposent une société raciste.
Il est utile de comparer la vie des immigrés de l’après-guerre – et des immigrés africains-américains dans les villes du nord des Etats Unis- aux premières vagues d’immigration en Europe et en Amérique. Entre les années 1890 et 1920, il y a eu un afflux important d’Européens de l’Est en Grande-Bretagne, d’Italiens et de Portugais en France et d’Européens de l’Est et du Sud aux Etats-Unis. Ces nouveaux immigrés étaient souvent accueillis avec la même hostilité que les immigrés noirs de l’après-guerre. Ils étaient également accusés d’être des étrangers, d’être moins intelligents, dépravés et de mœurs faciles, enclins à la violence, aux drogues et à l’alcool.
Et pourtant, ils se sont finalement intégrés dans les pays d’accueil, alors que personne ne pensait, comme maintenant, que leur présence était le signe d’une société “multiculturelle”. Le contraste entre l’immigration d’avant-guerre et celle d’après guerre se trouve moins du côté des immigrés eux-mêmes que du côté des pays d’accueil. Trois grands changements sociaux ont rendu la quête de l’intégration et de l’égalité encore plus difficile. D’abord, la capacité matérielle de la société à créer l’égalité s’est émoussée. Les crises qu’ont subies les économies occidentales depuis les années 70 ont contribué à renforcer la marginalisation des immigrés noirs et des Africains-américains.
Deuxièmement, l’idée d’une culture commune s’est affaiblie. L’effondrement de l’union de l’après-guerre et la fin de la Guerre froide ont créé une atmosphère de fragilité et d’angoisse, dans laquelle l’idée d’une identité nationale cohérente est devenue problématique. Particulièrement aux Etats-Unis où la Guerre froide fournissait un ennemi commun externe et un sentiment de mission à accomplir autour desquels s’articulait l’identité américaine. La perte de tout cela a miné la croyance à une culture commune englobant tout le monde.
Troisièmement, et peut-être de manière plus importante, l’idée de l’égalité elle-même s’est transformée. L’incapacité des luttes comme les mouvements pour les droits civiques aux Etats-Unis à transformer la vie de la majorité des Africains-américains a sapé le moral des antiracistes. Militer pour l’égalité signifie remettre en question des pratiques acceptées, être prêt à marcher à contre-courant, croire que les transformations sociales sont possibles. En revanche, célébrer les différences entre les peuples nous permet d’accepter la société telle qu’elle est –il suffit de dire : “nous vivons dans un monde de diversités, profitons-en”. Cela nous permet d’accepter les divisions et les inégalités qui caractérisent le monde aujourd’hui.
Les mutations sociales qui ont balayé le monde ces dix dernières années ont intensifié ce sentiment pessimiste. La fin de la Guerre froide, l’effondrement de la gauche, l’écroulement de l’ordre d’après guerre et la fragmentation des mouvements sociaux ont brisé de nombreuses certitudes du passé. En particulier, ils ont remis en question notre capacité à améliorer le monde. Dans ce contexte, la recherche de l’égalité a été généralement abandonnée en faveur de la revendication pour une société diversifiée. L’idée du multiculturalisme, comme celle de la race, vise à s’accommoder des inégalités dans une société qui prêche l’égalité. Tandis que les théoriciens du racisme disaient que les différences sociales étaient le résultat inéluctable des différences naturelles et qu’on ne pouvait rien y faire, les multiculturalistes prétendent qu’elles sont le résultat des différences culturelles et qu’on ne devrait rien y faire. Mais c’est simplement donner un autre nom à l’inégalité.
L’égalité n’est pas une “excentricité occidentale”. Elle concerne notre capacité universelle à agir en tant qu’égaux politiques. Dans une société égalitaire, cette capacité peut prendre une multitude de formes et peut donc devenir la base d’une réelle différence. En effet, ce n’est que dans une société égalitaire que la différence peut vraiment avoir un sens, car ce n’est que là que la différence peut être librement choisie. Dans une société inégalitaire, cependant, la recherche de la différence signifie bien trop souvent le renforcement d’inégalités déjà existantes. Les inégalités sont tout simplement reformulées dans une théorie de la “différence”. Le problème aujourd’hui n’est pas d’adopter la “différence” en tant qu’objectif politique mais de dépasser tout ce vocabulaire sur la race et de se déclarer clairement en faveur de l’égalité.
Remerciements : cet article a d’abord été publié dans “ The Future ”, numéro anniversaire de Index on Censorship, n° 3/97, mai 1997, et est publié ici avec l’autorisation des éditeurs.
Index on Censorship, Lancaster House, 33 Islington High Street, Londres, N1 9LH, Royaume Uni.