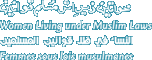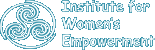Barbara Hendricks : « Le blues, c’est le courage de protester »
Publié le 24 novembre 2015 - Par Clarisse Juompan-Yakam.
À 67 ans, la cantatrice explore les racines de la musique africaine-américaine et exalte la dimension politique et contestataire de ces airs de résistance.
La Scala de Milan, l’Opéra de Paris, le Metropolitan Opera de New York… Depuis plus de quarante ans, sur les plus grandes scènes du monde, Barbara Hendricks donne le frisson aux amateurs d’opéra. Sous la direction de Maazel, Barenboïm ou Bernstein, la femme noire, née dans le Sud ségrégationniste des États-Unis, met sa voix exceptionnelle au service des plus grands compositeurs : Mozart, Puccini ou Verdi. Comme pour réunir le monde noir et le monde blanc. Il y a vingt ans, lors d’un passage au Festival de Montreux, elle a ajouté le jazz à son répertoire. DansBlues Everywhere I Go, enregistré en live au Scalateatern de Stockholm et sorti sous le label Arte Verum, la maison de disques qu’elle a lancée en 2006, Barbara Hendricks explore les racines de la musique noire américaine et exalte la dimension politique et contestataire de ces magnifiques airs de résistance. Splendide collier nigérien autour du coup, celle qui dit se sentir totalement africaine, européenne et américaine, convoque toute une page de l’histoire des États-Unis.À 67 ans, la cantatrice explore les racines de la musique africaine-américaine et exalte la dimension politique et contestataire de ces airs de résistance.
Jeune Afrique : Il y a vingt ans, vous avez ajouté le jazz à votre immense répertoire classique. Cette démarche correspond-elle à un retour aux sources ?
Barbara Hendricks : Dans une certaine mesure, oui. Mais ce n’était pas le but recherché au départ. J’ai commencé à chanter du gospel à 12 ans, dans l’église de mon père, pasteur méthodiste dans l’Arkansas. J’évoluais également dans le chœur de l’école, où nous avions un large répertoire, y compris classique, sans aucune hiérarchie entre ces musiques. Puis j’ai découvert le jazz avec le pianiste Arthur Porter. En 1994, j’ai parlé de mon admiration pour Duke Ellington à Claude Nobs, le fondateur du festival de jazz de Montreux, en Suisse, où j’habitais. Il m’a alors invitée à lui rendre hommage. J’ai apprécié l’expérience, que j’ai voulu renouveler en enrichissant mon répertoire de pièces du Great American Songbook, composées notamment par George Gershwin, Duke Ellington ou Cole Porter.
Renouer avec le jazz vous a amenée à rencontrer le blues, dites-vous…
Oui, j’ai pris conscience que pour être une bonne chanteuse de jazz, je devais aller à la rencontre du blues, m’intéresser à son histoire, comme je le fais d’ailleurs pour la musique classique. Les negro spirituals de mon enfance représentent les racines américaines du blues et du jazz. C’était des chants religieux qui mêlaient rythmes africains et hymnes chrétiens pour exprimer la souffrance d’un peuple captif. Après la fin de l’esclavage, cette musique sacrée est devenue le gospel. Mais elle a aussi un pendant profane, jugé peu sophistiqué – même dans certains milieux noirs -, perçu comme la musique de ceux qui n’ont pas de culture, le blues. Il était chanté dans les bars et les clubs où l’alcool coulait à flots. Le blues ne trouvait pas grâce aux yeux de mon père, qui le considérait comme la musique du diable. J’ai donc dû m’en tenir au gospel. En le réécoutant, j’ai découvert une musique extraordinaire qui me touche et que j’ai envie de partager.
Qu’est-ce qui vous touche ?
Le blues est une émotion prégnante. Il vous saisit aux tripes sans nécessairement passer par le cerveau. Ce qui me touche, c’est à la fois la musique et les thèmes abordés. Né dans les plantations du delta du Mississippi, le blues raconte la vie comme elle est, avec ses joies et ses peines. Certes, il redit l’oppression, la cruauté et l’injustice des lois ségrégationnistes de Jim Crow dans le sud des États-Unis dans les années 1950, mais ce n’est pas seulement le chant de la détresse humaine. Il véhicule aussi de l’espoir.Oui, avec ses protest songs, le blues a été un outil décisif de la lutte pour les droits civiques. Je l’ignorais. L’un des titres qui me bouleverse le plus, c’est Strange Fruit. Composé par le Juif new-yorkais Allan Lewis et interprété pour la première fois par Billie Holiday en 1939 au New York Café Society, il est devenu le symbole de la lutte pour les droits civiques menée par Martin Luther King. Les fruits étranges qui se balancent dans les arbres du Sud, ce sont des corps de Noirs lynchés et pendus par le Ku Klux Klan. Plus qu’un style musical, le blues est l’expression du courage de protester contre ces avilissantes lois Jim Crow et ces autres règles implicites, non dites, qu’il fallait néanmoins connaître.
Enfant, aviez-vous conscience de l’existence de ces lois ségrégationnistes ?
J’ai eu une enfance protégée. À 8 ans, j’ai soudainement mûri. Je venais d’assister en direct, à la télévision, chez mes voisins, au combat de neuf écoliers noirs de Little Rock pour intégrer l’école de leur choix, comme les y autorisait désormais la loi. En voyant la haine de ceux qui tentaient de les en empêcher, j’ai pris conscience que j’étais étrangère chez moi. Qu’on pouvait m’exclure de tout, me blâmer, non pas pour un méfait quelconque, mais en raison de la couleur de ma peau.
Ces chansons trouvent-elles encore une résonance dans le monde actuel ?
Elles prennent des accents contemporains avec des affaires comme celles de Cleveland, de Ferguson et de New York, où les trois protagonistes sont tombés sous les balles de la police. Le premier avait 12 ans et jouait avec un pistolet factice. Ces morts ne sont peut-être pas pendus aux arbres, mais ils sont bien morts d’être noirs. Ces dernières bavures policières et autres tueries racistes aux États-Unis nous rappellent que rien n’est jamais acquis.
Comment la petite fille noire du Sud ségrégationniste a-t-elle pu se prendre de passion pour la musique classique, une musique composée par des Blancs ?
La musique est une expression de l’âme. C’est tout. Elle ne peut donc être « racialisée ». Petite fille, j’adorais chanter. Ma voix de soprano s’est vite affirmée, en même temps que ma passion pour le chant et la musique. J’ai décroché des bourses, grâce à mes résultats. Et j’ai pu développer mon talent. Mon père appréciait le côté pratique des choses : je pouvais subvenir à mes besoins sans rien attendre de lui. Mes parents ne m’ont pas encouragée : ils n’ont jamais compris que la diplômée en mathématiques que j’étais se lance dans la musique. Ils n’assistaient pas à mes concerts. Barbara Hendricks sur scène, pour eux, ce n’était pas moi. Tant mieux : j’ai évolué sans pression. Ce n’est que plusieurs années après le début de ma carrière que mon père m’a assuré qu’il a toujours pensé que je devais chanter.
Existe-t-il des ponts entre le blues et le classique ? Entre Mozart et Count Basie ?
Dans le Requiem de Mozart, je perçois énormément de blues. L’humanité est africaine. Il est donc normal que la musique africaine soit le ferment de toutes les autres. Sans ma plongée dans le negro spiritual, je ne chanterais pas la musique classique de la même manière. La pratique du jazz m’a appris à improviser quand je chante Haendel, par exemple.
Vous sentez-vous une proximité avec certains artistes africains ?
J’en connais quelques-uns, dont Youssou Ndour, qui s’est récemment produit à Stockholm. C’était extraordinaire. Je n’avais jamais vu une salle de concert avec autant de monde debout, qui bougeait dans tous les sens. Il y a quelque temps, j’ai chanté avec Angélique Kidjo pour le compte du HCR. Peut-être le fait d’être femmes nous a-t-il rapprochées.
Nombre d’Africains-Américains s’emploient à retrouver les traces de leurs lointains ancêtres africains. Et vous ?
Je serais curieuse de savoir d’où je viens, mais cette quête identitaire n’est pas un besoin absolu. Mon fils Sebastian a entrepris des recherches, qui nous situeraient plutôt du côté de l’Éthiopie, ce qui nous semble curieux. Mes grands-parents sont descendants d’esclaves mais aussi indiens Choctaw, une tribu installée en Louisiane et dans le Mississippi, et dont la plupart ont été envoyés dans des réserves en Oklahoma.
Vous souvenez-vous de votre premier contact avec l’Afrique ?
Ma première rencontre avec le continent, c’était en Zambie, en 1987, dans un camp de réfugiés ; le premier que je visitais en tant qu’ambassadrice de bonne volonté du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies. J’ai tout de suite été frappée par la générosité de gens privés de tout, mais prêts à partager le peu qu’ils avaient. Dans mon enfance, alors qu’il était beaucoup question de ségrégation et de droits civiques, on ne regardait pas en direction de l’Afrique, considérée comme un continent de conflits et de pauvreté. Très peu d’Africains-Américains avaient un tropisme africain. C’est venu dans les années 1970, avec un mouvement comme le Black Power.
Vous aviez pourtant été invitée avec insistance à vous produire en Afrique du Sud du temps de l’apartheid.
J’ai toujours refusé. Ils avaient même osé m’assurer que je pouvais descendre dans le même hôtel que mon mari blanc. J’aurais alors eu le privilège d’être « honorary White », « Blanche honoraire ». Je leur ai répondu que je viendrais le jour où je serais simplement considérée comme un être humain.
Vous dites avoir rencontré de grands Africains.
Ils sont nombreux. Kofi Annan, ex-secrétaire général des Nations unies. Nous avions en commun notre engagement à défendre les réfugiés et les droits humains. Il a beaucoup apporté à l’ONU, bien que les États-Unis aient essayé de le torpiller avec leur intervention en Irak. Il y a aussi le Nobel de littérature Wole Soyinka. Un grand homme, que j’ai soutenu pendant son exil, alors qu’il était condamné à mort dans son pays. Je me souviens lui avoir recommandé de se couper les cheveux pour être moins reconnaissable. Il avait refusé net. Parmi les femmes, il y a la défunte militante écologiste kényane Wangari Maathai, Nobel de la paix 2004, ainsi que la présidente du Liberia Ellen Johnson-Sirleaf. Comment évoquer les grands Africains sans parler de Nelson Mandela ? Son exemple prouve que si on ose l’amour, le regard sur l’autre, on peut trouver des solutions à n’importe quelle crise.
Vous faites peut-être allusion à la crise des migrants ?
Nous sommes forcés de vivre ensemble. Il faut trouver le moyen de le faire de façon acceptable pour tous. Cette crise peut être salutaire si elle donne aux Européens – dont je suis – l’occasion d’une véritable introspection. Il faut avoir le courage d’élaborer une politique d’immigration respectueuse de la dignité humaine. Pendant vingt-cinq ans, on a laissé ceux qui propagent la haine et la xénophobie confisquer la parole dans l’espace public. C’est le moment de revenir en arrière. La peur de l’autre domine et nos dirigeants sont, eux, parfois paralysés par la peur de ne pas être réélus. Ils ne doivent pas oublier que certains d’entre eux ont fait partie de la coalition qui est intervenue en Irak en 2001. Ni Daesh ni Al-Qaïda n’existaient alors.
Vous étiez présente à Rome, lors de la création de la CPI. Trouvez-vous normal que seuls les Africains comparaissent ?
Il y a vraiment des gens que j’aurais aimé voir à La Haye : George Bush, Tony Blair… Ce sont des criminels de guerre. La guerre en Irak était illégale et immorale, bête aussi. Nous en mesurons aujourd’hui les conséquences. Ce qu’il y a de plus choquant, c’est la manière dont elle a été conduite par les États-Unis. Alors qu’ils avaient planifié des attaques, ils n’ont pas hésité à envoyer à Bagdad des émissaires du HCR parmi les plus dévoués, rapidement visés par un attentat. Personnellement, j’y ai perdu un ami très cher, Sergio Vieira de Mello, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme. Nous étions tous fiers d’appartenir à cette organisation, qui n’est pas parfaite mais qui a permis un certain nombre d’avancées. Au moins il y a une première justice : le monde entier sait que cette guerre était fondée sur un mensonge. Et je ne désespère pas pour la CPI