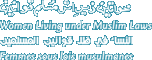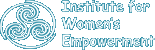Libye: Notre très embarrassant ami Kadhafi
Muammar Kadhafi veut éviter à tout prix la contagion et exerce une répression extrêmement dure dans l'Est de la Libye. Il s'agit pour lui d'éviter que “l’épidémie” ne s’étende, car si la révolte arrivait jusqu’à Tripoli, le régime serait en péril. C’est pourquoi, en particulier à Benghazi et à Al-Baïda, il a ordonné de tirer sur les manifestants; mission confiée à des mercenaires. Ce choix d’employer des “missionnaires” africains − notamment des Tchadiens et des Ougandais − permet de libérer de tout conditionnement, clanique ou tribale, ceux qui doivent tirer sur les manifestants. Le pouvoir évite ainsi que les contradictions du sang se répercutent dans l’armée. Même les cortèges funèbres en l’honneur des victimes n’échappent pas à la violence brutale de la répression.
Les opposants, eux, invoquent la liberté. En effet, les innovations législatives annoncées en 2008, conditions sine qua non à la réintégration de la Libye dans la communauté internationale − la réforme du code pénal et des procédures pénales (dans un pays où s’opposer aux objectifs de la Révolution islamique constitue un délit) et l’abolition de la peine de mort − sont restées lettre morte. Toutefois, la révolte qui gronde dans le Golfe de Syrte peut-elle renverser Kadhafi, au pouvoir depuis plus de quarante ans, et aboutir à ce qu’une “république dynastique” succède au colonel ? L’absence d'alternative dans le leadership semble rapprocher le cas libyen des cas égyptien et tunisien. Par ailleurs, la spirale liberté/pauvreté, certes incomparable à celle qui sévit en Égypte car concentrée en grande partie à l’Est du pays, où la protestation est la plus forte, est cependant similaire à celle qui a incendié les autres pays nord-africains.
En revanche, le conflit libyen présente d’autres lignes de fracture. Le problème provient avant tout de l’affrontement classique entre le centre et la périphérie, qui se déroule le long d’un axe Est-Ouest. Ce n’est pas un hasard si le conflit a éclaté à Benghazi − ville historiquement opposée à la domination de Tripoli −, à l’occasion de la commémoration du massacre d’opposants au régime dans la prison d’Abou Salim en 1996, au cours duquel l’artillerie, qui tirait à bout portant, assassina plus de mille prisonniers politiques. Un évènement que le gouvernement libyen s’est toujours refusé à éclaircir. C’est en effet l’omnipotente Agence de sécurité intérieure qui est chargée du contrôle de la prison, ainsi que de l’autre structure destinée aux prisonniers politiques, Aïn Zara. Cette branche des renseignements peut, de façon arbitraire, prolonger la détention de nombreux opposants politiques considérés comme dangereux, même s’ils ont été acquittés par le tribunal ou même s’ils ont déjà purgé leur peine. Le régime a essayé d’étouffer ce massacre d’Abou Salim en proposant une indemnisation aux familles des victimes − largement refusée − pour qu’elles renoncent à porter plainte auprès des tribunaux nationaux et internationaux.
En outre, la Libye est moins sensible aux pressions extérieures que l’Égypte ou la Tunisie. Son long isolement international a imperméabilisé un régime qui exerce un contrôle totalitaire sur le pays. L’exportation de ressources énergétiques et l’investissement de capitaux libyens dans de grandes entreprises européennes, en particulier italiennes, permettent au pouvoir de répondre aux pressions. Voire d’en exercer à son tour. Après les premières protestations émises par l’Union européenne, les Anglais et les Français, la Libye rétorque que si le soutien aux opposants ne cesse pas, elles pourrait mettre fin à sa collaboration sur le front de l’immigration. Cela ouvrirait grand les portes du Maghreb et de l’Afrique à des exodes colossaux, qui frapperaient surtout l’Italie, point naturel d’arrivée des flux provenant des ports de ce qui fut l’Italie Impériale. Manifestement, cette menace terrorise Rome, mais il est urgent d’en discuter, au moins au siège de l’Europe. Et ce sans être paralysé par une realpolitik qui s’est avérée très fragile ces dernières semaines.
22.02.2011 | Renzo Guolo | La Repubblica