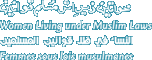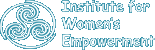Maghreb: Sophie Bessis: Statuts des femmes au Maghreb
Ce « moderne » - appelons ainsi les mutations contemporaines qu’a connues la région pour éviter le terme, porteur d’un autre sens, de « modernité » - existe donc aussi banalement qu’ailleurs. C’est que la tradition, elle, n’existe pas. Tradition et modernité : ce couple d’opposés a fait fortune au point de résumer, l’une, l’essence même de la pensée et de l’action en mouvement vers le progrès, l’autre, l’immobilisme supposé être la norme des cultures situées hors de l’orbite de ce mouvement. La seconde a essentialisé la première pour en faire un invariant doué d’éternité, afin de se poser comme son inverse irréductible puisqu’elle postule le changement permanent. Or, l’histoire récente nous apprend que la tradition ne cesse de se réinventer à travers d’insolites appropriations de la modernité, et que ce qu’on croit souvent sculpté dans le marbre de l’ancien est une tradition « récente », cet oxymore résumant une partie des contradictions que connaît aujourd’hui le monde arabe. C’est dans ce contexte, nous semble-t-il, qu’il convient d’aborder la question des femmes dans cette partie du monde. Hormis quelques incursions au Machrek, on se cantonnera pour ce faire au Maghreb, qui constitue notre champ de recherches spécifique.
Les prémisses d’une modernité maghrébine ?
Avec celles d’Égypte, et de Syrie dans une moindre mesure , les élites tunisiennes entrent, dès les années 1850, dans un ardent débat sur la modernité. La transformation de la Régence en une quasi-monarchie constitutionnelle en 1857, les réformes introduites par le premier ministre Khereddine dès avant la colonisation, la multiplication d’ouvrages qui prônent l’urgente nécessité de moderniser la société, illustrent la vivacité de cette tension vers le nouveau, vers ce tajdid que les élites dites « éclairées » sont pressées de mettre en œuvre. Si, plus tard, Bourguiba maniera plus d’une fois l’arme du nationalisme populiste, il est aussi l’héritier de cette histoire qu’il voulut et put faire fructifier, contrairement à ceux qui, en Orient, prirent les rênes de leurs pays à peu près en même temps que lui.
L’Algérie, précocement et bien plus que d’autres déstructurée par une conquête brutale et une colonisation exceptionnellement longue, ne connut pas ce phénomène, même si quelques libéraux - de Ferhat Abbas à Ahmed Boumendjel - crurent un moment pouvoir entraîner le mouvement de libération nationale dans le sillon de la modernité. Ce ne fut pas le cas, mais l’Algérie indépendante sembla pourtant s’y convertir en adoptant le « socialisme », ce mode d’exercice du pouvoir par le contrôle des moyens de production et de la société consubstanciel au XXe siècle. Volonté moderne là encore, mais censée s’incarner avant tout, comme dans l’Égypte nassérienne ou l’Irak baathiste, dans les fumées sortant triomphalement des toutes nouvelles cheminées d’usines. Le Maroc, enfin, gouverné par une monarchie se revendiquant fièrement de sa profondeur historique, et puisant une part non négligeable de sa légitimité dans son aptitude à défendre un appareil de traditions considérées comme le socle de la « personnalité » marocaine. Mais ce vieux trône, aussi, fut obligé de tenir compte des conséquences du choc colonial, et devint vite conscient qu’il lui fallait se dépoussiérer pour durer.
Après l’épisode colonial, la seconde moitié du XXe siècle accélère les changements : croissance démographique multipliant par trois le nombre d’habitants en moins d’un demi-siècle et urbanisation accélérée de sociétés restées jusqu’aux années 1950 profondément rurales, émergence de classes sociales nouvelles comme les petite et moyenne bourgeoisies, conversion massive au salariat de la population d’âge actif, scolarisation - plus ou moins importante selon les pays, le Maroc accusant en la matière un retard manifeste - qui touche aussi les filles, voilà quelques-unes des mutations les plus spectaculaires du dernier demi-siècle.
Dans les trois pays, les femmes sont concernées par ces changements considérables, sans pour autant en profiter pleinement. Rien là que de très banal, le même constat pouvant être fait pour le XXe siècle européen. Dans cette Europe qui revendique d’être le creuset d’une modernité à vocation universelle, les femmes en sont longtemps demeurées le « continent noir ». Partout en Occident, on note un décalage chronologique entre les progrès de la modernité politique et ceux de la place et du statut réservés aux femmes dans la société et dans le droit. L’égalité juridique des sexes y est, on le sait, récente, et le processus commence à peine dans le champ politique.
N’est-ce pas ce type de décalage qui sépare les deux rives de la Méditerranée ? En d’autres termes, n’enregistre-t-on pas une simple assymétrie temporelle entre ces rives ? C’est l’argument qu’avancent nombre d’observateurs locaux des évolutions de leurs pays, et une partie non négligeable des classes politiques des trois États. Laissons « du temps au temps », disent ces défenseurs de la prudence, pour ne pas brusquer - au risque de les braquer - des sociétés déjà traumatisées par les bouleversements qu’elles connaissent. Il n’y aurait rien de grave, à les en croire, à aider sans hâte excessive les traditions à s’effacer devant une modernisation inéluctable, et qui a déjà commencé .
L’argument est d’autant plus séduisant qu’il replace le débat dans l’histoire, au lieu de faire de l’altérité supposée des Arabes un absolu intemporel et de l’islam un objet a-historique, exclu de la temporalité des sociétés qu’il a contribué à modeler. Et l’on sait combien la tentation est grande aujourd’hui, au Nord du monde, d’assigner l’autre à une identité aussi fantasmée que figée. Mais, pour pertinent qu’il puisse paraître, cet argument n’est pas vraiment convaincant. Parce que - on l’a dit - la tradition a bon dos, et ce qu’il en reste sert aujourd’hui toutes les manipulations. Mais aussi parce que la question de la condition féminine est au centre de tous les débats qui agitent le Maghreb depuis un siècle, et davantage dans le cas tunisien, et qu’il partage cette centralité non avec l’Occident, mais avec l’ensemble du monde musulman. Enfin, parce que l’itinéraire de cette région vers la modernité ne peut être ni linéaire ni mimétique, même si l’Europe a présenté le récit de sa trajectoire historique singulière comme la voie droite universelle vers le progrès. Sans verser dans l’essentialisme qui envahit la quasi-totalité des discours actuels occidentaux sur « l’islam », dont les exégètes autoproclamés font fureur, il faut donc explorer les raisons pour lesquelles les femmes constituent l’enjeu de société majeur au Maghreb et - plus largement - dans le monde arabe contemporain. Il faut se demander pourquoi c’est sur leur statut que toutes les mouvances politiques et idéologiques se déterminent, et à partir de lui qu’on peut dessiner les lignes de clivage qui fracturent l’espace politique maghrébin. Dernière interrogation, et non des moindres, celle de savoir pourquoi la question de l’avenir de la condition féminine est aujourd’hui l’objet de crispations beaucoup plus dures que celles que l’on constate chez les réformistes maghrébins et arabes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Maghreb urbain, Maghreb rural
Si l’on se penche sur les écrits de la période libérale de la pensée arabe, portée par des couches dominantes urbaines numériquement restreintes, on voit que la question du « progrès » de la condition féminine est au centre du propos sur la modernité. Ce propos se formule, certes, dans le langage de l’époque. Il n’en demeure pas moins d’une audace étonnante, compte tenu du contexte dans lequel il s’inscrit. L’Égyptien Kacem Amin (1863-1908) peut s’insurger contre l’imposition du voile dès la fin du XIXe siècle en s’écriant : « C’est quand même étonnant ! Pourquoi ne demande-t-on pas aux hommes de porter le voile ou de dérober leur visage au regard des femmes s’ils craignent tant de les séduire ? La volonté masculine serait-elle inférieure à celle de la femme ? » En 1913, un Mansour Fahmy (1886-1959), lui aussi Égyptien, condamne radicalement, dans la Condition de la femme dans l’islam , le sort que cette religion réserve au sexe féminin. Il est certes puni de sa témérité en étant renvoyé de l’Université. Il représente tout de même un segment non négligeable de la pensée de cette période. Et en 1930, le Tunisien Tarek Haddad (1898-1935), pourtant sorti de l’université théologique de la Zitouna, publie un ouvrage révolutionnaire, intitulé Notre femme dans la loi et dans la société , dans lequel il prône un changement radical du statut des femmes, et compare le port du voile « à la muselière qu’on met aux chiens pour les empêcher de mordre ». Lui aussi est sanctionné par des oulémas majoritairement conservateurs. Son ouvrage ne s’inscrit pas moins dans un courant qui traverse le Machrek aussi bien que le Maghreb. On pourrait multiplier de tels exemples pour constater que tous ces auteurs posent la même question qu’Amin : « Devons-nous vivre ou nous condamner à mourir et à disparaître ? [...] Nous devons comprendre comment les gens ont progressé et comment nous avons régressé. » Et tous sont convaincus que le progrès tant souhaité de leurs sociétés passe d’abord par les femmes.
Ces dernières ne restent pas spectateurs passifs de ce bouillonnement. De nombreuses femmes, elles aussi issues des bourgeoisies citadines, aspirent à changer de statut. En 1924, la publication, par l’Union des femmes égyptiennes, d’une brochure réclamant l’abolition de la polygamie et le remplacement du privilège masculin de répudiation par une véritable procédure de divorce, et les propos sulfureux sur le voile tenus à Tunis par Manoubia Ouertani, sont quelques manifestations de l’émergence d’un courant qu’on peut déjà qualifier de « féministe », grâce au début de modernisation des sociétés arabes et surtout de la scolarisation des filles de la bourgeoisie . En 1930, le premier Congrès des femmes d’Orient se tient à Damas pour réclamer l’égalité des sexes en prônant une série de réformes.
Très présent dans le débat jusqu’aux années 1930, ce courant s’estompe sous les coups de boutoir des partis nationalistes, auxquels se rallient progressivement les masses maghrébines épuisées par le joug colonial. Mais, loin de suivre le courant libéral sur le chapitre des femmes, ces mouvements voient plutôt dans le maintien de leur condition le gage le plus sûr de la protection d’une « identité » mise en péril par la présence coloniale. Or, pour eux, comme pour les oulémas demeurés très conservateurs, le statut de l’identité a pour mesure celui des femmes. Sur cette ligne, le cheikh algérien Abdelhamid Ben Badis se déclare dans les années 1930 favorable à l’instruction des filles, mais uniquement « sur la base de notre religion et de notre personnalité islamique » . Ces partis ne se privent pas pour autant de l’engagement des femmes dans les luttes de libération nationale. Il fut partout massif. Mais la question féminine pèse lourdement sur la controverse qui s’esquisse autour de la nature du projet de société postcolonial, dont les mouvements de libération se veulent les futurs constructeurs.
Ces années voient en fait la fin d’une époque et d’une classe. Si les libéraux du début du siècle passé faisaient preuve de hardiesse, c’est qu’ils demeuraient convaincus d’avoir vocation à conduire eux-mêmes et à leur manière leurs pays vers la modernité et de leur capacité à encadrer les changements, sans prévoir que la violence de ces derniers les emporteraient. Tout en s’insurgeant, par ailleurs, contre le fait colonial, ils appartenaient encore par leur mode de pensée au courant moderniste précolonial fasciné - à l’instar de la bourgeoisie ottomane représentant à bien des égards leur modèle - par un Occident qu’ils ne voyaient pas encore tout à fait comme oppresseur. Sans s’affranchir totalement d’un carcan religieux qui commençait à peine à se fissurer, ils se donnaient pour arme la lecture la plus ouverte possible des prescriptions inscrites dans les textes canoniques.
Les générations suivantes ne s’inscrivent pas dans le même contexte. En se prolongeant, d’abord, la colonisation aggrave son oppression. Et la naissance des partis nationalistes propulse les masses sur le devant de la scène, ces masses rurales spoliées de leurs terres par les colons, chassées des campagnes par la misère qui s’y étend, désespérées par l’exploitation coloniale. La religion est pour elles le début et la fin, car elle revêt une pluralité de sens. Elle légitime, en premier lieu, l’ensemble des structures qui font le socle de sociétés profondément conservatrices : patriarcat et patrimonialisme, modes de production, hiérarchies sociales et sexuelles, soumission absolue de l’individu au groupe. Ce n’est pas, cette fois-ci, la tradition qui a bon dos, mais le Coran. Quand il arrive à ce dernier de contredire la coutume, c’est la coutume qui gagne, appelée religion . C’est tout un mode de vie et les valeurs qui le fondent que la secousse coloniale est en passe de détruire. Et les ruraux de l’Atlas, des Aurès ou des steppes tunisiennes appellent ce mode de vie « islam ». C’est donc logiquement en son nom qu’on se bat contre l’occupant. Ainsi se confondent, et pour longtemps, islam et identité. Ainsi, la religion rurale gagne sur celle des villes. Or, contrairement à la première, la seconde a été adaptée par le travail des élites aux processus d’individuation. Après les indépendances, les générations suivantes répètent cette victoire grâce à la pression démographique alimentant l’exode rural. Ces flux migratoires successifs expliquent en partie l’impossible émergence d’une modernité politico-sociétale portée par des élites urbaines régulièrement submergées par les vagues rurales. L’urbanisation plus précoce et plus profonde de la Tunisie par rapport à ses voisins a permis, a contrario, de pousser beaucoup plus loin qu’eux la modernisation des statuts personnels une fois l’indépendance acquise.
L’installation durable de ces néo-urbains dans la sphère du pouvoir avec les indépendances ne fait pas à elle seule comprendre la centralité de la référence religieuse au Maghreb, comme dans le reste du monde arabe. Elle vient de plus loin et prend ses racines dans une profondeur historique qu’on ne peut réduire à quelques décennies. Inscrite dans le contexte colonial puis postcolonial, la ruralisation des villes permet cependant d’identifier une des causes de l’interruption de la marche vers la modernité et la force du lien qui s’est tissé entre le religieux et l’identitaire. À l’inverse, l’urbanisation des ruraux fait comprendre pourquoi la condition des femmes n’est pas restée immobile. Car leur refus d’une modernité aux antipodes de tout un système de valeurs, lequel se traduit par l’installation de pouvoirs autoritaires reproduisant dans le champ politique le patrimonialisme communautaire, n’empêche pas ces nouvelles couches d’être séduites par une modernisation dont elles ont économiquement besoin et à laquelle elles sont prêtes à faire des concessions. Le cas algérien est emblématique de ces ambiguïtés. Puisqu’aux yeux des oulémas comme du FLN l’islam est la valeur fondatrice de la personnalité algérienne : la proclamation du 1er novembre 1954 affirme que la lutte a pour but « la restauration de l’État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques ». En 1959, la réponse de l’organe du FLN El-Moudjahid à la promulgation d’une ordonnance coloniale interdisant la répudiation et rendant le divorce judiciaire obligatoire est d’une rare violence : « Ainsi, des Français, au surplus chrétiens ou de confession israélite comme l’est, paraît-il, M. Michel Debré, ont osé de propos délibéré porter atteinte au Coran, de par son essence immuable, et imposer par le sabre aux musulmans d’Algérie les lois laïques de France et ce dans la matière la plus sacrée, à savoir le statut personnel [c’est nous qui soulignons]. » C’est entendu : toucher au statut des femmes représente le pire coup qu’on puisse porter à l’intégrité de l’être algérien. Pourtant, le programme de Tripoli, élaboré en 1962 par un mouvement national sachant l’indépendance imminente, reconnaît qu’il existe dans la société algérienne une « mentalité négative » vis-à-vis des femmes, et que le FLN a le devoir de « rendre irréversible » sur ce chapitre « une évolution inscrite dans les faits ». Il ne faut pas voir une contradiction entre les propos du Moudjahid et le programme de Tripoli, mais un projet : oui, « la » femme peut et doit évoluer, mais à l’intérieur d’un cadre normatif qu’il lui est interdit de contribuer à définir et, a fortiori, de transgresser. Et si la norme doit s’adapter à une modernisation jugée irréversible, elle doit le faire à l’intérieur du corpus des principes islamiques ou supposés tels.
La tradition a peu à voir, on en conviendra, avec ce qui se joue au cours de cette période. L’identité la remplace, cette construction réactive moderne née de la conscience d’une menace réelle ou imaginaire, peu importe. Cette crainte vient de l’ampleur et de la rapidité - vues comme dévastatrices - des mutations, et de la permanence du projet hégémonique occidental, incarné d’abord par la colonisation, puis par le renouvellement postcolonial des formes de la domination et enfin, aujourd’hui, par une mondialisation considérée comme le terme historique de l’occidentalisation du monde.
Or, on l’a vu, le statut de l’identité dépend de celui de la femme, légitimé par ce que tous appellent islam, qui a des contenus différents selon que l’idée de la menace se rapproche ou s’éloigne. Cette confusion des deux statuts, l’un et l’autre figés par l’onction divine, explique que les femmes ne peuvent éviter d’être l’enjeu central des projets de société maghrébins, le discours islamiste étant, dans ce contexte, la version la plus récente et la plus extrême de la panique identitaire.
De la « promotion » des femmes à l’évolution des rapports de genre
Comme le pressentait le FLN, comme l’avait compris Mohammed V en présentant en 1947 aux notables du Makhzen sa fille aînée dévoilée, comme le savait Bourguiba mieux que tout autre, le changement fut irréversible. On l’a dit, la place des femmes dans la société et les sociétés elles-mêmes évoluent plus vite durant les cinquante dernières années qu’au cours des quelques siècles précédents. Et, contrairement à la première moitié du XXe siècle, ces changements n’affectent plus seulement les vieilles bourgeoisies urbaines, d’ailleurs plus ou moins laminées par l’État postcolonial et par la montée des nouvelles classes sociales. L’urbanisation, la scolarisation, la généralisation de l’économie du salariat, l’extension de la contraception aux femmes des couches populaires dès les années 1960 en Tunisie et à partir des années 1980 en Algérie et au Maroc, leur entrée dans des sphères demeurées jusque-là strictement masculines, la relative mixité qui s’instaure dans l’espace public, sont les manifestations les plus remarquables du changement de la condition féminine. Dans le domaine législatif c’est, dès l’indépendance et pour les raisons historico-sociologiques qu’on a dites, que la Tunisie va le plus loin dans la réforme. Hormis quelques résistances vite jugulées, les Tunisiens, et plus encore les Tunisiennes, acceptent, avec enthousiasme souvent, les innovations radicales contenues dans le Code du statut personnel promulgué en 1956, trois mois à peine après l’indépendance . La révolution juridique qu’il représente est complétée au cours des quarante années suivantes par une série de réformes consolidant les droits des femmes et facilitant leur insertion dans l’espace public et la vie économique. Alors que le Code de 1956 avait à bien des égards précédé l’évolution, celle-ci commande ensuite les avancées législatives encouragées par des équipes dirigeantes successives profondément marquées par le réformisme. Sans pour autant briser le cadre normatif dans lequel s’insèrent ces avancées : le maintien de l’inégalité successorale entre garçons et filles et l’interdiction faites aux filles d’épouser un non-musulman rappellent que le privilège de masculinité reste la norme et que les femmes ne peuvent jouir d’une autonomie surveillée qu’à l’intérieur de leur communauté.
En 1956, le Makhzen marocain est bien loin de la tornade bourguibienne. L’alliance du trône et des oulémas fait de la Mudawwana promulguée en 1957 une simple traduction en langage moderne du droit malékite. La femme y est privée des droits les plus élémentaires, et se voit tout au plus accorder quelques mesures protectrices destinées à atténuer les conséquences les plus néfastes du pouvoir discrétionnaire des hommes. Les velléités modernistes ne sont pourtant pas absentes du discours politique, surtout à gauche. Mais elles sont trop timides pour faire pression sur un Hassan II qui refuse toute modification du statut des femmes. Ici, c’est l’évolution sociétale et le développement d’un mouvement féministe dès les années 1980 qui permettent, au terme de quinze ans de batailles, de faire bouger les choses. L’arrivée en 1999 sur le trône d’un roi qui se veut moderne contribue également à mettre fin à l’immobilisme d’une loi devenue totalement inadaptée à la société. En 2003, la Mudawwana est fortement toilettée. Sa nouvelle version modifie substantiellement le statut juridique des femmes. Les féministes elles-mêmes le reconnaissent, sans pour autant être vraiment satisfaites de ce conservatisme qui se veut désormais « éclairé ». Tout en insistant sur la filiation charaïque de la réforme, le souverain n’en a pas moins voulu montrer que la lecture de la loi coranique pouvait se libéraliser. Mais dans un cadre normatif plus restrictif encore que celui de la Tunisie. Est-ce parce que l’Algérie est obsédée par la question de l’identité que le statut des femmes n’a cessé d’y régresser depuis l’indépendance ? Contrairement, en effet, à ses deux voisins dont l’existence nationale et étatique précède de loin la colonisation, l’idée de nation algérienne s’est forgée au cours de la période coloniale, et le processus de formation de l’État n’y est pas achevé. La radicalité de la francisation n’a rien eu à voir non plus avec celle des deux protectorats que sont restés la Tunisie et le Maroc. Ni grignoté par le modernisme comme en Tunisie, ni institué en monopole monarchique comme au Maroc, l’islam, érigé en socle de l’identité, a voisiné avec des choix « socialistes » strictement confinés à la sphère économique, se réservant - avec l’approbation de l’État - la mainmise sur la société. Cette hégémonie du religieux, que le régime n’a su ni voulu contrôler, différencie l’islamisme algérien de celui de ses voisins. Les leaders islamistes - les radicaux comme les « modérés » associés au pouvoir - ont toujours refusé les concessions au moderne et se sont élevés contre toute velléité des segments modernistes du régime de répondre aux aspirations des femmes en modifiant les lois de statut personnel. La promulgation en 1984 du Code de la famille le plus étroitement conservateur du Maghreb prouve l’étendue de son influence. Et, contrairement aux apparences, la guerre « contre le terrorisme » qui a déchiré le pays entre 1992 et 1999 ne l’a pas entamée. Tandis que, pendant sa brève existence légale à la fin des années 1980, le parti islamiste tunisien Ennahdha avait assuré ne pas vouloir remettre en cause l’essentiel du Code du statut personnel, tandis qu’en 2003 les mouvements islamistes marocains se sont résignés à accepter du bout des lèvres la réforme de la Mudawwana, leurs collègues d’Algérie ont de nouveau réussi en 2004 à bloquer toute modification substantielle du « code de l’infamie », comme l’appellent les féministes algériennes.
Ainsi, les législations promulguées par les États anticipent, entérinent ou refusent l’évolution des pratiques sociales, selon qu’ils sont plus ou moins tenus par la contrainte islamo-identitaire.
Mais là n’est pas, si l’on peut dire, le plus important. Ce qui l’est davantage, c’est que ces évolutions n’aboutissent pas seulement à une modernisation de l’insertion sociale des femmes. Elles ont aussi pour résultat, beaucoup plus radical, de bouleverser la nature même des rapports de genre qui la structurait. Cela explique que ce qu’on nomme encore la « question des femmes », mais qu’il faut désormais appeler la « question des rapports de genre », ait pris un tour nouveau et soit plus que jamais au centre des projets politiques concurrents qui se disputent les faveurs des masses. C’est ce bouleversement-là, et non la simple modernisation de la condition des femmes, aujourd’hui acceptée par à peu près tout le monde, y compris par la majeure partie de la mouvance islamiste, qui peut expliquer le changement de décor qu’on observe depuis une quinzaine d’années. En faisant irruption sur la scène publique, les femmes, volontairement ou pas selon les groupes et les circonstances, ont fait éclater le cadre normatif grâce auquel la société des hommes entendait contrôler leur émancipation. Ce faisant, elles ont vidé de son sens tout le système hiérarchique reposant sur la sexuation des rôles domestiques et sociaux. Cette mutation - le mot prend ici son sens le plus fort - est une mise en danger de l’ensemble de la société. Encore une fois, elle n’est pas spécifique au monde arabe. C’est plutôt la nature et la violence des réactions qu’elle suscite qui fait la spécificité de ce dernier.
La nostalgie de l’ordre masculin comme remède à la déréliction L’omniprésence de l’islam dans la formulation et la protection des codes sociaux patriarcaux est sans nul doute à l’origine d’une partie de cette violence. En Europe, le processus de laïcisation fut un facteur déterminant de la libération des femmes en ôtant toute légitimité religieuse à leur infériorité et en accélérant les processus d’individuation. Dans le monde arabo-musulman, la permanence de la légitimation religieuse - à laquelle aucune force politique ne s’est avisée de toucher - explique la lenteur de la sécularisation et la forte résistance des logiques claniques et communautaires aux processus d’individuation. Les incertitudes sociales, les conséquences d’une modernisation biaisée et la violence des pouvoirs en place ne sont pas étrangères non plus à la crispation réactive d’une partie de la société. En privant leurs populations de tout accès à la modernité et en ne tolérant que leur modernisation technique, les équipes dirigeantes ont procédé à une tragique déconnexion entre les outils et le sens. En fermant tout accès à la pluralité, non seulement dans le domaine politique mais dans celui de la pensée, elles ont laissé le référent islamique occuper tout l’espace de cette dernière. C’est donc à lui qu’ont eu recours les jeunes générations scolarisées désespérées par l’inéluctable montée du chômage, par l’aggravation des inégalités sociales, dues pour partie à l’âpreté des clans dirigeants, et par l’arbitraire de l’instance politique. Le « dégoûtage », pour employer un des néologismes favoris de la jeunesse algérienne, provoqué par l’absence d’horizon, a amplifié une contestation puisant essentiellement ses arguments dans la rhétorique religieuse. Les frustrations de segments importants des nouvelles petites bourgeoisies urbaines éduquées, mais plus ou moins prolétarisées par les dysfonctionnements économiques et marginalisées par l’ambiguïté des choix linguistiques, ont par ailleurs fourni à cette contestation ses intellectuels et ses idéologues. C’est en revanche chez les minorités sociales restées en relations avec l’extérieur que continuent de se recruter une bonne partie des partisans de la modernité, qu’ils savent conditionnée par l’expulsion du religieux de la sphère publique. Les majorités perçoivent de ce fait le discours de la modernité comme l’expression politique des franges intellectuelles les plus aisées. L’hostilité de ces dernières à la prééminence du religieux est en outre assimilée à une trahison de l’identité, et les fait regarder comme la cinquième colonne d’un Occident honni pour son « arrogance », ce hezb França voué en Algérie à la vindicte des islamistes. C’est également de ce milieu qu’est issue la majeure partie des animatrices des mouvements féministes. Dans ce contexte troublé, le bouleversement des rapports de genre devient le résumé de toutes les menaces, la cause unique de la décomposition de l’ordre social, à l’origine du brouillage des repères. La restauration souhaitée de cet ordre ne peut donc venir que du renforcement du contrôle des femmes et de la réitération de leur soumission à l’autorité masculine. La transgression féminine serait, en somme, à l’origine de tous les maux contemporains. La rhétorique islamiste répète ad nauseam cette vulgate qui présente l’avantage d’être simple et de répondre à la perte du sens généralisé chez les jeunes générations masculines. Seul le retour à la vérité d’un islam des origines, évidemment imaginaire, permettra de retrouver le sens en garantissant de nouveau la plénitude de l’autorité patriarcale. Si les pères avaient accepté et souvent encouragé la relative émancipation de leurs filles, les frères la refusent, et vont former le gros des troupes de l’islam politique. Les pères étaient parfois conservateurs, les fils sont réactionnaires. La violence de leur réaction, qui s’exprime à l’égard de leurs femmes et de leurs sœurs, est le plus souvent proportionnelle au sentiment qu’ils ont de leur inutilité dans l’espace social, usurpé à leurs yeux par les intrusions féminines . Celles-ci ne sont pas purement fantasmatiques. En Tunisie et au Maroc, où les femmes représentent environ le quart de la main d’œuvre salariée industrielle du fait de la priorité donnée par leurs pays aux industries manufacturières, elles sont souvent les seules de la famille à avoir un salaire régulier, ce qui leur donne un pouvoir inédit. Elles n’en profitent pas toujours, loin de là, mais elles pourraient le faire, c’est là le danger. Dans les trois pays, les filles représentent depuis la fin des années 1990 la majorité des effectifs de l’enseignement supérieur (56 % en Tunisie), et les femmes diplômées sont en passe de devenir plus nombreuses que leurs homologues masculins. Bridées dans la fonction publique dont le haut encadrement reste un quasi-monopole masculin, elles investissent les postes de direction dans le privé et se dirigent vers les affaires, à tous les niveaux : dans le petit et le grand commerce, dans l’industrie de la confection et les activités tertiaires de pointe. Les associations dirigées par des femmes sont légion, et forment la trame des sociétés civiles, particulièrement au Maroc. Bref, elles deviennent des concurrentes dans des sociétés où le chômage des hommes illustre la perte de leur autorité, tandis que celui des femmes leur fait retrouver le chemin de la sphère domestique. On pourrait donc croire que les hommes des mouvances les plus réactionnaires souhaitent le retour des femmes à la maison. Bien que l’idéal de la femme cachée connaisse un vrai regain, ils ne le peuvent pas, car l’économie et le secteur public ne peuvent plus se passer d’elles. Dans les trois pays, elles forment les gros bataillons de l’enseignement, du secteur médical et des tranches inférieures de la fonction publique. Voilées ou pas, des centaines de milliers d’entre elles prennent tous les jours - de Rabat à Tunis - le chemin de l’usine. Contrairement aux familles élargies économiquement autarciques de l’ancienne société rurale, la famille nucléaire de la ville ne peut pas vivre grâce au seul salaire masculin. C’est pourquoi, à l’exception de marges infimes se signalant par une obsession misogyne qui rapproche leurs comportements de celui des talibans, l’écrasante majorité des populations séduites par le discours islamiste ne remettent pas en cause l’inscription des femmes dans la sphère économique publique. Pour parer aux dangers que représente à leurs yeux une évolution des rapports de pouvoir entre les sexes, elles veulent restreindre leur autonomie en mettant en place les outils normatifs et symboliques qui marqueraient ses frontières. Les leaders islamistes comprennent, quant à eux, qu’ils seront abandonnés des femmes, c’est-à-dire de plus de la moitié de l’électorat dans chaque pays, s’ils s’opposent à leur désir de modernisation. Au Maroc, c’est la fille du dirigeant islamiste le plus populaire du pays, Nadia Yassine, qui déclare en 2000 : « Je suis la première à dire qu’il faut un nouveau statut de la femme. Mais il faut qu’il soit fondé sur notre culture... [Les féministes] sont des femmes qui vivent à l’heure de Paris, de Washington, mais pas de Rabat. » Les contours de l’espace public dévolu aux femmes font ainsi l’objet d’incessants compromis avec les nécessités du réel. Les plus radicaux prônent, à l’instar du leader charismatique du FIS algérien au début des années 1990, Ali Bel Hadj, un apartheid sexuel - écoles non mixtes, transports publics séparés - qui limiterait le danger représenté par l’exposition publique des femmes. Celles-ci devraient en effet, dans l’idéal, avoir pour vocation d’être seulement des « mères de musulmans ». Les modérés, ou ceux qui veulent se présenter comme tels, se contentent du hidjab, ce voile moderne plus commode à l’usage que le safsari ou la melia traditionnels, qui présente l’avantage de les cacher sans perturber d’aucune manière le fonctionnement économique ni l’espace public. Le numéro un du FIS Abassi Madani va même jusqu’à affirmer, en 1990 : « Nous n’imposerons pas de force une conduite donnée. La musulmane qui ne porte pas le voile est une croyante, mais elle n’a pas pu harmoniser sa foi avec son comportement. Le problème est donc d’ordre éducatif... » Purement électoraliste, une telle déclaration montre bien que les dirigeants de l’islam politique sont contraints de composer. Mais tous refusent que l’on touche aux fondements du droit charaïque comme la polygamie, même si elle a pratiquement disparu dans les faits. L’édifice religieux doit, en effet, demeurer intact pour garantir que l’évolution peut être contrôlée. Enjeux féminins et fractures politiques L’existence d’une importante composante féminine à l’intérieur des mouvances islamistes est une illustration de ces improbables compromis. Ces femmes protègent-elles seulement leur présence dans l’espace public en déclarant leur soumission aux nouvelles contraintes, ou estiment-elles celles-ci justifiées ? Certaines d’entre elles sont même des cadres de leurs mouvements et n’hésitent pas parfois, sans craindre la contradiction, à se qualifier de « féministes islamiques ». Les nombreux écrits sur elles qui ont été publiés depuis leur apparition publique tentent de percer l’énigme de leur adhésion volontaire au nouveau totalitarisme de la norme . Cette adhésion s’explique, nous semble-t-il, par les mêmes causes que celles qui ont jeté les hommes dans les bras de l’islam politique : existence du seul référent islamique dans l’offre idéologique proposée aux Maghrébins, désertification du paysage politique par des pouvoirs autoritaires qui ont fait des mosquées les seuls lieux d’expression de la contestation, contagion identitaire allant bien au-delà des mouvements religieux, il eut été surprenant que les femmes échappent à ce contexte et se situent hors de leur société. Comme les hommes, une partie d’entre elles ont donc choisi le projet politique de l’islam contemporain. Elles ont, toutefois, contribué à lui faire accepter certaines évolutions qu’elles veulent irréversibles, l’obligeant à tenir pour acquis - au moins, en partie - le changement en cours des pratiques sociales, même si la majorité des leaders masculins a tenté de freiner le mouvement. Les propos d’Aïcha Belhadjar, dirigeante en Algérie du Mouvement pour la société islamique (MSI) résument cette ambiguïté : « La société algérienne est musulmane et son évolution et son épanouissement ne peuvent se faire que dans le cadre de la chari’a. Si nous sommes musulmans, nous ne pouvons ni rejeter ni même discuter ce que le Coran a prescrit. » Et si ces prescriptions sont incompatibles avec la vie moderne, il faut essayer de trouver « des astuces... C’est là que l’intelligence doit jouer » . Il ne faut donc pas s’étonner de leur nombre, qui n’est que la manifestation la plus immédiatement visible de la fracture du champ politique maghrébin. Ces femmes contribuent aussi à faire la force de leurs mouvements. Car, contrairement aux mouvances laïques, elles savent mobiliser les masses féminines en leur parlant dans la langue qu’elles comprennent, celle du religieux. Dans des sociétés où l’adhésion à la laïcité est le plus souvent prise pour de l’athéisme, le discours de la modernisation conservatrice ne dépassant pas les limites de la prescription coranique et des interdits sociaux est bien mieux entendu que celui de la modernité. Elles ont en outre l’avantage d’être socialement plus proches de celles qu’elles veulent mobiliser, beaucoup d’entre elles connaissant le fonctionnement et les codes des cités populaires, contrairement aux femmes des « beaux quartiers ». Ce combat à armes inégales contre leurs adversaires explique leur succès. Car ni dans un camp ni dans l’autre, les femmes ne sont un simple enjeu de l’affrontement, elles en sont aussi les actrices. Plus ou moins modernes sans être modernistes, les islamistes formuleraient-ils en l’exagérant le sentiment majoritaire voulant que la modernisation doit respecter les limites fixées par le sacré pour ne saper ni l’ordre établi ni les repères identitaires ? L’équation, heureusement, n’est pas si simple, ce qui explique la profondeur des fractures séparant sur cette question les camps politiques opposés. Car, comme il y a un siècle, les Maghrébins ne peuvent envisager l’avenir de leurs sociétés sans poser la question de la modernité.
Comme à l’époque coloniale, mais avec d’autres formes, celle-ci demeure certes brouillée par la constance avec laquelle l’Occident défend sa position hégémonique et par les dérives impériales de sa puissance dominante. Mais les brouillages n’empêchent pas qu’elle soit posée avec plus d’acuité que jamais. Les manifestations autour du statut des femmes, qui ont rythmé au cours des quinze dernières années la vie politique maghrébine, ont illustré sa centralité dans le débat. Dans la première moitié des années 1990, avant que la guerre intérieure ne tétanise les Algériens, chaque manifestation organisée par les femmes pour revendiquer des droits, ou proclamer leur crainte de voir leurs maigres acquis remis en cause par la progression de l’islam politique, a fait descendre dans les rues des dizaines de milliers de personnes. Les associations féministes en ont certes été les instigatrices. Mais elles étaient suivies par de très nombreuses femmes de toutes les couches sociales, excédées d’être réduites par la loi au rang de mineures à vie et plongées dans une insécurité permanente du fait du maintien de la polygamie et de la répudiation qui continuent d’en faire les victimes de la toute puissance masculine. Les hommes ont participé massivement à ces mouvements, prouvant par là une fois de plus l’importance de l’enjeu. Également conscients de cette importance, les mouvements islamistes ont sorti à leur tour « leurs » femmes pour montrer que la rue algérienne était de leur côté. Ils organisèrent aussi d’énormes manifestations, ou femmes et hommes défilaient séparés, afin de proclamer l’urgence de la restauration de la loi religieuse pour sauver l’Algérie de sa déréliction. Au Maroc, la campagne « du million de signatures », lancée au début des années 1990 par les organisations féministes pour la réforme de la Mudawwana, avait eu un gros succès. En 1999, leur pression sur le gouvernement socialiste d’Abderrahmane Youssoufi le conduit à publier un « plan d’intégration des femmes au développement » contenant d’importantes avancées du droit. Les deux principales formations islamistes, El Adl wel Ihsan et le Parti pour la justice et le développement, y voient aussitôt une volonté de « colonisation culturelle de l’Occident » . Résolus à défendre le plan, quelque 100 000 femmes et hommes descendent dans les rues de Rabat, le 12 mars 2002, pour réclamer entre autres, comme les Algériennes, l’abolition de la polygamie, de la répudiation et de la tutelle matrimoniale. Le même jour, les mouvements islamistes en mobilisent le double à Casablanca. Durant les années 1990, ces rassemblements concurrents ont réuni de part et d’autres des centaines de milliers de personnes, hommes et femmes confondus, pour réclamer, les uns la préservation dans toute sa plénitude de la norme religieuse afin de « protéger » la société, les autres son abandon pour faire avancer cette même société vers la modernité.
En Tunisie, l’absence de telles manifestations s’explique à la fois par l’autoritarisme du régime et par une législation beaucoup plus favorable aux femmes. Les mouvements féministes y dénoncent toutefois la permanence d’inégalités juridiques et les violences misogynes dans la sphère privée. Elles ont, ces dernières années, fait porter une part de leurs revendications sur la question de l’inégalité devant l’héritage. Mais, quelles que soient ses insuffisances, la reconnaissance du Code du statut personnel - érigé en 1989 par le pouvoir en « acquis de la nation » - y est devenu la ligne rouge séparant les fractions modernistes de la société de celles qui sont séduites par l’islam politique. S’il prend des formes différentes liées à l’histoire de chacun des pays, s’il est plus ou moins violent selon le contexte politique et l’état du rapport des forces entre les mouvances qui portent l’un et l’autre projet, l’affrontement a partout le même contenu. Il mobilise, d’un côté, les partisans d’une nouvelle distribution des rapports de genre, que chacun s’accorde dans ce camp à lier à la sécularisation du champ politique et de la société : l’Association tunisienne des femmes démocrates réclame ainsi la laïcité « d’une part, dans l’idée de mettre fin à l’artificielle et redoutable sacralisation des inégalités et de la discrimination à l’égard des femmes, d’autre part, dans l’idée d’émanciper les règles régissant les rapports humains et la vie collective de tout impératif les transcendant... » . Les divergences entre les modernistes tournent autour de la question de savoir si l’expulsion du religieux de la sphère publique est un préalable à la sécularisation, ou si l’on peut plus facilement atteindre cette dernière par une interprétation de l’islam compatible avec les exigences de la modernité. Au tryptique modernité-égalité-sécularisation répond, dans le camp adverse, le binôme islam-identité.
Comme il y a un siècle, comme au tournant des indépendances, presque dans les mêmes termes, la bataille se poursuit. Et les jeux ne sont pas faits. Toute l’expérience arabe contemporaine montre que l’envie du moderne n’est pas un gage d’accès à la modernité. Comme il y a un siècle, et de l’Atlantique au Golfe, les femmes sont l’enjeu de la bataille, mais plus qu’il y a un siècle ses protagonistes aussi, avec les mêmes incertitudes sur son issue. Et, comme jadis, le sort qu’on leur réserve est la meilleure mesure de ce qui bouge dans la société. Rien hormis le décor n’aurait donc changé ? Paradoxalement, la violence de l’affrontement actuel fait penser à certains qu’il pourrait s’agir de sa dernière phase et que la prééminence de la norme religieuse, portée par un puissant mouvement politique, est inéluctablement condamnée. Mais on sait aussi depuis longtemps qu’il n’y a pas de sens de l’histoire. Et le spectacle contemporain du naufrage du progrès montre que le monde peut changer sans avancer.
Source: Association du Manifeste des libertés
Sophie Bessis, née en 1947 à Tunis, est une historienne et journaliste franco-tunisienne.
Elle est issue d'une grande famille de la grande bourgeoisie juive tunisienne. Agrégée d'histoire et ancienne rédactrice en chef de l'hebdomadaire Jeune Afrique et du Courrier de l'Unesco, elle est actuellement directrice de recherches à l'Institut de relations internationales et stratégiques de Paris et secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH). Elle a longtemps enseigné l'économie politique du développement au département de science politique de la Sorbonne. Consultante pour l'Unesco et l'Unicef, elle a mené de nombreuses missions en Afrique.
Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont une biographie d'Habib Bourguiba avec la contribution de Souhayr Belhassen.