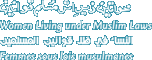Algérie/France: Massacres du 17 Octobre 1961 à Paris: pour la reconnaissance de ce crime d'Etat
Pour rappel, le 17 octobre 1961 des milliers d’Algériennes et d’Algériens, venant des immenses bidonvilles de Nanterre et de plusieurs villes de banlieue, avaient, à l’appel du Front de libération national algérien, manifesté pacifiquement dans plusieurs quartiers parisiens, Champs-Elysées, République, Opéra, Saint-Michel, la Concorde, etc. Ils avaient réclamé la levée du couvre-feu, qui leur avait été imposée, depuis le 1er octobre 1961, de 20h30 à 5h30.
La levée de ce couvre-feu était vitale pour les chefs de la résistance algérienne, tant ses effets attendus étaient dévastateurs, pour la guerre d’indépendance de l’Algérie. Et pour cause, l’immigration représentait le poumon économique de cette guerre. Or ce couvre-feu aurait gêné considérablement la collecte des fonds le soir dans les cafés, les bars et les foyers pour travailleurs, fréquentés par les Algériens.
De leurs côtés, les divers centres de décision français étaient décidés, bien que pour des raisons diamétralement opposées, à baigner cette manifestation dans le sang. Pour les uns (de Gaulle et son clan), il fallait négocier en position de force, dans l’espoir de préserver quelques privilèges néocoloniaux, de l’inéluctable indépendance de l’Algérie ; et pour les autres (les ultras colonialistes de l’Algérie française tels que Michel Debré, Premier ministre, Roger Frey, ministre de l’Intérieur, Maurice Papon, de sinistre mémoire, préfet de Paris…) pour saborder les négociations en cours avec le Gouvernement provisoire de la république algérienne, en vue de maintenir le peuple algérien, sous les bottes de leurs maîtres, les capitalistes coloniaux.
Il n’est pas inutile non plus de préciser que Papon avait été nommé à ce poste, au lendemain de la manifestation, le 13 mars 1958, vers l’Assemblée nationale, de 2 000 policiers au cri : « Sales Juifs ! A la Seine ! Morts aux fellagas ! »
La répression, qui avait durée du 17 au 20 octobre, avait vu policiers et gendarmes, déjà gangrenés par le racisme, l’antisémitisme et les idées d’extrême droite, battre avec sauvagerie les manifestants algériens, auxquels ils ligotaient parfois les mains et les noyer dans la Seine. Des milliers d’autres avaient été pourchassés ou pris dans des rafles sur les quais de métro, ainsi que dans les rues de Paris et de banlieue ; les blessés étaient laissés, sans soins, et beaucoup parmi les prisonniers avaient été torturés. Le bilan parmi les manifestants s’était élevé à au moins 200 morts, 400 disparus, des milliers de blessés et près de 12 000 Algériens officiellement arrêtés.
Cependant, nombreuses furent les voix de ce pays qui avaient condamné cette violence inouïe des forces de répression parmi les intellectuels républicains de gauche, anticolonialistes ou libéraux ; les journaux progressistes ou libéraux ; les partis politiques et les associations de gauche ; et les organisations religieuses ou communautaires protestantes ou juives.
Comme les années précédentes, les républicains anticolonialistes s’activent à laver cette autre souillure que les colonialistes firent à la France. Celle-ci doit, selon eux, s’en débarrasser en reconnaissant le crime d’État, qu’a été le massacre de la manifestation du 17 octobre 1961, comme elle a su le faire avec courage et dignité pour d’autres causes, dans un passé récent. Cette reconnaissance aidera les victimes, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, français dans leur quasi-totalité, à faire enfin leur deuil et à tourner une page de l’histoire de France pour un avenir serein commun.
Ces républicains sont bien conscients qu’il leur faut, dans leur quête de justice, combattre, outre les nostalgiques de l’« Algérie de papa », les tenants de trois écueils, déjà unis par leur commune confusion de la république avec ce qu’en ont fait ses fossoyeurs à tel ou tel moment de son histoire. Ces trois écueils, qui se nourrissent mutuellement, sont le négationnisme, la relativisation des crimes contre les peuples et la hiérarchie entre les victimes de ces crimes. Ils sévissent malheureusement chez une frange de la gauche laïque, qui a perdu une partie de ses repères : les uns, quelquefois francophobes, servent de marche-pied à la droite et l’extrême droite islamiste, et les autres, musulmanophobes et négrophobes, servent de marche-pied à la droite et l’extrême droite chrétienne.
Il n’est pas inintéressant de rappeler le contexte de ce second couvre-feu ; le premier, décrété pour le 1er septembre 1958, avait été rendu inapplicable. Fin août 1958, les chefs de la Fédération de France du FLN décident d’étendre la lutte armée à la métropole. Pourtant, malgré la répression, dont les résistants algériens faisaient l’objet depuis le premier jour de l’insurrection, le 1er novembre 1954, ils s’étaient limités vaille que vaille à l’affrontement fratricide et sanglant avec le Mouvement nationaliste algérien, de Messali Hadj.
Leurs objectifs visaient à faire découvrir aux Français de Métropole la réalité de la guerre et à desserrer l’étau sur les unités de l’Armée de libération nationale, sérieusement mises à mal dans les maquis en Algérie. C’est ainsi qu’ils avaient incendié ou détruit un grand nombre d’installations économiques, attaqués de nombreux commissariats et abattu ou blessé des dizaines de collabo et de policiers, généralement ceux qui s’étaient distingués par leur cruauté envers les Algériens.
La décision d’« exporter » la lutte armée en métropole ne fut pas moins une grave erreur politique et militaire. En effet, ces attentats ne pouvaient que desservir, sur tous les plans, la cause algérienne. La conséquence la plus grave et immédiate avait été de donner toutes les justifications pour élever de plusieurs crans la répression, dont le couvre-feu, contre la communauté algérienne et les réseaux de sa résistance dans l’Hexagone.
Par: Hakim Arabdiou
Respublica n°603 - samedi 8 novembre 2008