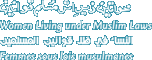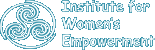Egypte: Tortures en Egypte ou la haine du pauvre
Ahmad Sobhi, 35 ans, est accusé par la police locale d’« agression contre les autorités » et il attend que le juge statue sur son inculpation. Magda Adly, médecin anesthésiste, militante contre la torture, explique au juge : « J’ai examiné Ahmad, il a eu une hémorragie à l’œil et a perdu l’ouïe suite aux coups avec barres de fer qu’il a reçus au visage. Après avoir arraché ses vêtements, les policiers l’ont traîné par les pieds, tout nu, de son quartier jusqu’au commissariat de police, sous les yeux de tous. Son père et son cousin ont ensuite été incarcérés. Le ventre et la poitrine du père sont couverts de brûlures de cigarettes. » Les officiers de la Sécurité d’Etat présents dans la salle sont stupéfaits de la témérité de cette femme qui a fait le voyage spécialement du Caire pour les incriminer publiquement.
Lorsque la séance est levée, Magda Adly est violemment attaquée : un policier la frappe à la tête et lui arrache son sac à main, elle tombe et perd conscience. Au Caire, la nouvelle choque tous ceux qui s’impliquent dans la défense des libertés. Tout le monde connaît Magda Adly, directrice du centre Al Nadim de réhabilitation psychologique des victimes de tortures, une institution vieille de 15 ans, dont la crédibilité et la pugnacité forcent le respect de tous. Agée d’une cinquantaine d’années, Magda Adly a de grands yeux éternellement étonnés derrière une paire de lunettes désuète et des cheveux grisonnants noués à l’arrière. Avec ses collègues du Centre Al Nadim, elles ont imposé le respect parce que, en quinze années de militantisme, elles ne se sont jamais laissées enkystées dans la « bureaucratie humanitaire ».
Quelques semaines après l’agression, Magda Adly reçoit, dans le petit appartement meublé simplement où elle vit avec sa mère et sa fille, un flux incessant de visiteurs venus exprimer leur soutien. Son épaule disloquée est soutenue par une attelle, mais son regard exprime toujours ce mélange étrange d’étonnement à la fois grave et jovial. « L’idée d’ouvrir Al Nadim était au départ celle de trois de mes amis, tous psychiatres, et qui, dans les hôpitaux où ils travaillent, ont été en contact avec des patients qui ont été torturés. Ils ont ouvert Al Nadim en 1993 et moi je les ai rejoints quelques mois plus tard, leur idée me plaisait parce qu’elle joignait deux choses essentielles dans ma vie : la médecine et le militantisme contre la dictature », évoque Magda Adly.
L’obtention d’aveux est rarement la raison de la torture
L’idée d’Al Nadim est née en 1989 après la répression des grèves des aciéries où délégués syndicaux et militants et leaders de gauche avaient été arrêtés et férocement torturés. « C’était la première fois qu’on approchait de cette façon des gens qui ont été soumis à la torture, qu’on voyait en direct les traumas laissés par la torture », se souvient Aida Seif al Dawla, l’une des trois psychiatres, avec Suzanne Fayad et Abdallah Mansour, qui ont fondé Al Nadim. Les bureaux d’Al Nadim se trouvent au centre-ville du Caire, côté populaire, aux deuxième et troisième étages d’un bâtiment à deux pas du quartier des vendeurs de pièces détachées, non loin de la grande et éternellement animée avenue Ramsès. Les appartements sont spacieux, la lumière y entre par de grandes fenêtres, et dans la salle d’attente, il y a toujours deux ou trois personnes assises, silencieuses. Souvent leur dénuement matériel est visible. Al Nadim emploie aujourd’hui sept médecins, dont six sont des femmes, deux avocats et un responsable administratif. Les trois amis psychiatres voulaient au départ s’en tenir à apporter une aide thérapeutique appropriée aux personnes qui ont été torturées, mais ils ont vite été obligés de revoir leurs objectifs. Impossible dans le cas des traumatismes causés par la torture de se confiner à la thérapie psychologique : l’idée même de « réhabilitation » passe par la quête de justice et la lutte contre l’impunité. « Lorsque la peur commençait à disparaître, que les cauchemars ne les hantaient plus, certains patients nous disaient : je vais mieux, mais je suis profondément triste, ma dignité a été bafouée, évoque Magda Adly, notre travail a beaucoup évolué, nous avons appris énormément avec les gens que nous avons soignés et suivis. » C’est ainsi qu’au travail de clinique médicale est venu s’ajouter celui d’information, de conseil légal, de campagnes médiatiques, de publication de rapports et de statistiques, d’accompagnement juridique. « Qu’une personne qui n’est ni leader d’un parti d’opposition ni militant des droits de l’homme, qui se considère comme un anonyme, se voit accompagner par dix ou quinze personnes au bureau du procureur, fait partie de la réhabilitation », souligne Aida Seif al Dawla.
Grande, la carrure robuste, le cheveu noir de jais, le rire franc et tonnant, Aida Seif al Dawla est une femme impressionnante. Qui semble pourtant habitée par un impénétrable blues. Lorsqu’elle relate les premières années d’Al Nadim, c’est surtout l’ampleur des surprises qu’elle et ses amis ont vécues qui lui vient à l’esprit. Ces femmes, médecins engagées, militantes ou sympathisantes de mouvements de gauche qui pensaient bien connaître leur pays, tombaient des nues face à la laideur du réel ordinaire qui dépassait tout ce qu’elles imaginaient. Elles s’attendaient à recevoir des militants politiques, mais de 1993 à 2000 il n’en fut rien, « tous ceux qui s’adressaient à nous étaient et sont encore majoritairement des gens ordinaires qui se font torturer pour des raisons que la raison ne peut accepter », explique Aida.
Selon Aida et Magda, les victimes de tortures le sont très rarement dans le but d’obtention d’informations ou d’aveux. En Egypte, disent-elles, on peut se faire torturer parce qu’on refuse de vendre au chef du village la petite portion de terre qui fait vivre la famille ; parce qu’on refuse de vendre l’appartement dans lequel on vit ; parce que l’on a un différend avec une personne qui a des relations dans la police et qui les envoie « vous donner une leçon » ; parce qu’on refuse de payer la dîme aux policiers véreux. Les citoyens qui refusent de se faire racketter sont rares, car ils savent bien que la conséquence du refus c’est la torture ; Magda Adly dit : « Aujourd’hui, tu ne peux plus aller chez un épicier, un restaurateur ou même un simple boulanger qui ne te dise pas : le poste de police m’oblige à leur envoyer des repas gratuitement… »
Les victimes : les plus pauvres parmi les pauvres
Et l’on découvre en écoutant les femmes d’Al Nadim que l’écrasante majorité de ceux qui se font torturer en Egypte ont « un dénominateur commun », comme dit Aida, « ce sont tous des pauvres, des gens qui n’ont pas qui appeler en cas de problèmes et qui finissent sous la merci de la police ». En quinze années de pratique, les cas de personnes torturées appartenant aux classes moyennes sont rarissimes, « on peut les compter sur les doigts d’une seule main ». A la création du centre, parmi les projets d’importance était celui de dessiner la carte de la torture dans le pays, mais au bout de quelques mois, « nous avons réalisé que la carte de la torture est celle de l’Egypte, la torture se pratique dans tous les commissariats, dans les locaux des services de sécurité d’Etat, dans les postes de police, où qu’ils se trouvent, à l’université ou dans le métro, là où il y a présence policière, il y a possibilité de torture », affirme Aida Seif al Dawla.
Il est intéressant là de souligner qu’un centre comme Al Nadim ne reçoit pratiquement jamais de militants islamistes. Qu’ils aient été membres des Frères musulmans ou des groupes armés, les islamistes ne s’adressent pas au centre de réhabilitation psychologique, même s’ils font partie de la population des torturés. Pour eux, explique Aida Seif al Dawla, « la torture, l’emprisonnement, la souffrance font partie du contrat qu’ils ont fait avec Dieu et l’idée même de réhabilitation psychologique ne les intéresse pas ». En dépit du fait que les islamistes se sont eux-mêmes « exclus » des statistiques d’Al Nadim, le nombre de personnes qui frappent aux portes du centre augmente de manière constante. Chose plus choquante encore, une bonne part de ceux qu’Al Nadim prend en charge sont des réfugiés soudanais, somaliens, érythréens, c’est-à-dire ceux qui ont tout perdu chez eux, les plus démunis d’entre les démunis, le segment le moins protégé d’entre la population vulnérable.
Pour Aida Seif al Dawla, l’usage massif de la torture pendant les années 1990 à l’encontre des islamistes et « le mutisme complice de la société civile qui l’a accompagné » expliquent d’une part l’ampleur prise par le phénomène aujourd’hui. Les choses se sont, ensuite, radicalement détériorées depuis le 11 septembre 2001. « Avec ce qui est appelé la guerre contre le terrorisme, l’idée que le gouvernement égyptien puisse être embarrassé par ces pratiques devant les pays occidentaux est un gros mensonge. Comment comprendre que l’administration américaine se dise mécontente qu’il y ait des gens torturés en Egypte alors que, dans le même moment, elle nous exporte des suspects pour qu’on les torture ? », relève encore Aida qui avoue n’avoir jamais imaginé, en 1993, lorsqu’elle lançait avec ses amis Al Nadim, que les choses empireraient de cette façon.
Aujourd’hui, il n’est pas besoin d’éplucher les rapports d’Amnesty International ou de Human Rights Watch pour prendre la mesure du désastre. Il suffit de lire les faits divers de la presse indépendante égyptienne. Le paysage ordinaire des brutalités que subissent les pauvres gens y est étalé dans toute son horreur. Pas une semaine ne passe sans que ne soit rapportée la mort de tel citoyen ou de tel autre pour cause de tortures.
Il arrive même que le corps inanimé du torturé soit jeté en plein jour et sous les yeux de tous les passants sur le trottoir aux portes du commissariat (Al Massri Al Youm des 7 et 8 novembre 2007). C’est à croire que la répression des expressions politiques divergentes s’est couplée en Egypte, au fur et à mesure des bouleversements économiques, avec un incroyable acharnement contre les plus pauvres. Comment expliquer sinon que la machine policière nourrisse une telle haine du pauvre ? Comment comprendre que le fils d’une femme de ménage âgé de douze ans (Al Massri Al Youm des 19 et 26 août 2007) soit torturé jusqu’à la mort pour avoir volé une boîte de thé ?
Par: Daïkha Dridi
Source: www.siawi.org