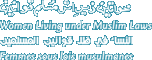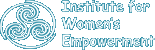Algérie: Film: "Histoire à ne pas dire"
Le film est le troisième volet de ce que le cinéaste appelle sa « Trilogie d’exil », un ensemble de trois documentaires qu’il a réalisés depuis 1993, moment où, face aux menaces d’attentats islamistes, il s’est trouvé contraint, comme plusieurs autres intellectuels et artistes algériens, de quitter son pays pour se réfugier en France.
Dans « Un rêve algérien », en 2003, il a filmé le retour d’Henri Alleg, l’auteur de La Question, le premier livre à avoir témoigné sur la torture pratiquée par l’armée française durant la guerre d’Algérie, sur les lieux où il avait vécu et où il avait été interné. Il y montre ses retrouvailles avec ses amis communistes algériens, anciens journalistes du quotidien Alger Républicain qu’il avait dirigé de 1950 à 1955, avant son arrestation par les militaires français, puis de 1962 à 1965, jusqu’au moment où le coup d’Etat de Boumediene avait provoqué la fermeture du journal et l’avait obligé à quitter le pays. Y apparaissait aussi l’ignorance patente aujourd’hui des jeunes Algériens quant à l’engagement d’Alleg et d’autres européens en faveur de l’indépendance.
L’année suivante, dans « Algéries, mes fantômes », Lledo donnait la parole à d’autres exilés en France : des Juifs d’Algérie, des pieds-noirs et d’anciens harkis qui avaient quitté le pays dans les années 1960, ainsi qu’à des intellectuels algériens qui avaient dû partir, plus tard, comme lui, dans les années 1990. A travers la juxtaposition de leurs témoignages, on y sentait l’expression de son propre sentiment personnel de déception immense vis-à-vis d’une société qui obligeait ainsi certains de ses fils à partir, on y sentait sa façon de ressentir l’histoire de l’Algérie indépendante comme une longue série d’exclusions successives, d’occasions manquées pour un pays qui aurait pu être multiethnique et multiculturel.
Le troisième volet de la trilogie, « Algérie, histoires à ne pas dire », a été, lui, entièrement tourné en Algérie, mais son thème essentiel est encore l’Absent, celui qui n’est plus là et dont la mémoire même tend à disparaître. L’absence d’un chef de maquis probablement victime d’un règlement de comptes entre indépendantistes et dont la mort reste obscure, celle d’une femme qui a risqué sa vie pour l’indépendance algérienne mais qui est aujourd’hui déçue par l’islamisation de son pays, celle des Juifs qui ont dû quitter un pays dont ils constituaient l’une des plus anciennes populations, et celle de ces descendants d’immigrants espagnols d’Oran, qui étaient loin d’approuver l’OAS et entretenaient de bons rapports avec les Arabes et dont certains, pourtant, ont été victimes, à l’indépendance, de massacres aveugles.
Pour évoquer ces quatre absences, le film nous emmène successivement dans quatre régions d’Algérie, qui sont en même temps emblématiques de quatre moments-clés de la guerre d’indépendance. Dans chacune d’elles, un personnage revient sur son enfance avant 1962 ou cherche à reconstituer un épisode de ces années de guerre qui furent aussi les dernières de la colonisation française.
Nous sommes d’abord dans la région de Skikda, l’ancienne Philippeville, qui a été le cœur de l’insurrection du 20 août 1955 qu’on peut considérer comme le vrai déclenchement de la guerre d’Algérie. Là, le principal témoin, Aziz, se souvient que, dans le village de Beni Malek, son oncle Lyazid, chef du réseau local du FLN, a veillé à ce que les civils européens qui maintenaient de bonnes relations avec la population algérienne ne soient pas l’objet de massacres. Tandis qu’un autre témoin, qui avait participé à la même insurrection non loin de là, à El Halia, raconte comment des familles entières de civils européens ont été tués dans des conditions horribles.
Puis, à Alger, une femme nommée Katiba revient sur les lieux de son enfance dans la Casbah, elle se souvient de la directrice pied-noir d’une école de Bab-el-oued qui ne voulait pas d’une petite arabe, mais aussi de la « tante Angèle », elle aussi pied-noir, qui a imposé qu’on l’inscrive et l’a élevée comme une seconde mère. C’est elle qui l’a protégée quand des manifestants européens cherchaient des Arabes à lyncher pour se venger d’un attentat FLN. De retour là où elle avait habité et vécu, Katiba explique son adhésion totale, à l’époque, à la cause du FLN, et aussi combien la ville aujourd’hui a changé… comme le confirme le fait que certains de ses habitants actuels la prennent pour une Française. Quand elle évoque la Bataille d’Alger de 1957, marquée par le terrorisme aveugle pratiqué par les services français contre la population de la Casbah et par les ripostes du FLN, c’est l’occasion pour Jean-Pierre Lledo de l’interroger sur le fait que ce dernier ait parfois pris pour cibles des civils. Fallait-il répondre à la répression aveugle des militaires français et aux « ratonnades » des foules d’extrémistes européens par des attentats contre des dancings et des cafés fréquentés par les pieds-noirs ? La question taraude Lledo, qui songe aux autres drames que le non respect de la vie humaine provoquerait plus tard. Et il a raison de la poser, y compris à ces résistantes admirables que sont Katiba, ou son amie Louisette Ighilariz.
A Constantine, un autre témoin, originaire de cette ville, amène son fils devant la grande fresque qui représente les principaux maîtres de la musique arabo-andalouse, le malouf, dont cette ville est le haut lieu en Algérie, où il manque pourtant l’un des plus grands d’entre eux : cheikh Raymond Leyris, assassiné le 22 juin 1961 dans des conditions qui restent à déterminer. C’est l’occasion d’évoquer les échanges nombreux entre Juifs et Arabes du Constantinois, et leur culture longtemps commune – au point qu’un musicien raconte que, venu jouer, un jour, pour un mariage, il s’était demandé si les familles des fiancés pour lesquelles il jouait étaient juives ou arabes.
Enfin, à Oran, un témoin plus jeune, Kheir-Eddine, comédien, hanté, lui, par le terrorisme des années 1990 qui a notamment causé la mort du dramaturge Abd-el Kader Alloula, cherche à enquêter sur les massacres d’européens qui, le 5 juillet 1962 et dans les jours qui ont suivi, ont entaché dans cette ville les fêtes de l’indépendance. Il cherche à percer les silences et les occultations de l’histoire officielle, et, à force d’interroger des anciens, il découvre l’importance de la présence des descendants d’immigrants espagnols dans cette ville, en particulier dans le quartier pauvre de la Calère dont il ne reste plus rien aujourd’hui. Ils témoignent de ce que, là, malgré les discriminations de la société coloniale et les affrontements de la guerre, les descendants d’immigrants espagnols vivaient en bonne intelligence avec les algériens musulmans.
Ce film, dont plusieurs séquences dégagent une immense émotion, interpelle directement le passé et le présent de l’Algérie. De front, il s’en prend aux vérités officielles de ce pays et cherche à retrouver la trace d’un certain nombre de réalités qu’elles cherchent à dissimuler ou travestir. Toute vérité est bonne à dire, et, quand elle est dite par un cinéaste qui a le talent et l’humanisme de Jean-Pierre Lledo, son film mérite d’être vu et médité par tous ceux qui s’intéressent au passé franco-algérien comme au présent de l’Algérie. A cet égard, on ne peut que regretter qu’au moment de sa sortie en France à la fin de février 2008, il n’a toujours pas reçu de visa d’exploitation en Algérie et qu’aucune des avant-premières que le réalisateur avait voulu organiser d’abord dans ce pays et qu’il avait programmées à trois reprises entre juin et janvier 2008, n’a pu bénéficier des autorisations nécessaires.
Doit-on, pour autant, considérer que ce film donne à un public français, souvent peu informé et majoritairement habité par des idées reçues sur l’« œuvre positive de la France outre-mer », une idée exacte de la société coloniale en Algérie et de la guerre qui y a mis fin ? Conçu avant tout pour un public algérien, contribuera-t-il aussi à bousculer les clichés du public français qui, par exemple, continue souvent à désigner les combattants de l’indépendance algérienne par le terme péjoratif de « fellaghas » ? Puisque la sortie de ce film en France s’annonce beaucoup plus large que la diffusion des deux premiers documentaires de la trilogie, on aurait pu souhaiter, par exemple, que certains des sujets traités auparavant dans « Un rêve algérien » comme la torture pratiquée par l’armée française durant la guerre, y soient aussi évoqués par un interview. Car si la culture politique de Jean-Pierre Lledo lui fait probablement penser que ces faits qui renvoient, eux, aux mensonges d’une autre histoire officielle, celle française cette fois, sont largement connus et reconnus par tous, tel est loin d’être le cas en France. Le spectateur français, confronté en plein écran à un témoignage effroyable disant la violence de certains insurgés algériens du 20 août 1955, prêtera-t-il autant d’attention aux phrases du commentaire qui disent aussi, mais de manière plus générale et plus abstraite, la répression aveugle et tout aussi barbare de l’armée française, qui a frappé ensuite des civils algériens qui n’y étaient pour rien ?
Autre exemple de malentendu possible : en voyant évoquer le cas particulier du quartier populaire d’Oran qu’était la Calère, dans le vieux secteur de la Marine, certains spectateurs ne risquent-il pas de se sentir conforter dans leur idée que la fraternité régnait entre tous les habitants de la société coloniale ? Le film contient, certes, tous les éléments susceptibles de détruire ce mythe, il évoque les petits métiers où étaient cantonnés les Arabes, comme aussi, brièvement, les attentats meurtriers de l’OAS. Mais ces mentions n’ont pas la force de la séquence, par ailleurs magnifique par l’émotion qu’elle suscite, des vieux Algériens qui se souviennent des amitiés d’autrefois entre Arabes et descendants d’Espagnols, séquence qui risque d’être perçue par certains spectateurs comme une preuve du « bon temps de la colonie ». Car on ne dit pas que la Calère apparaissait comme une exception dans une ville d’Oran qui était l’une des plus ségréguée d’Algérie, où les quartiers européens étaient distincts du quartier juif (plusieurs fois saccagé par des foules européennes) et qu’ils ont été séparés, à partir de 1956, par un réseau de barbelés du secteur musulman, dont un quartier était appelé « le village nègre ».
Quant au parallèle suggéré plusieurs fois par Lledo entre la violence des islamistes des années 1990 et celles de certains chefs de maquis du FLN, n’est-il pas trompeur ? Le cinéaste est libre d’exprimer ses impressions et ses associations d’idées, mais on aurait tort, à mon sens, de prendre ce genre de rapprochements au premier degré, comme des analyses d’historien ou de politiste.
Ce film est une belle œuvre cinématographique, qui gagne à être, pour toutes ces raisons, entourée d’explications et de débats lors de ses projections en France, de manière à mieux la contextualiser et à éviter, autant que possible, les réceptions qui pourraient comporter des contresens.
On ne peut que souhaiter le fait que les citoyens et les associations s’en emparent. Et que la parole libre soit laissée aux cinéastes ! Leurs œuvres leur appartiennent ! Qu’ils laissent parler leur sensibilité, nous aident à déconstruire les mythes officiels et à refuser toutes les langues de bois ! Tel est précisément le rôle des artistes et des intellectuels, et, même quand ils se trompent, les citoyens se font un devoir de défendre leur liberté. Nombreux sont les Algériens à vouloir qu’après le Parti unique, on en finisse avec l’Histoire unique. Un pays se grandit à savoir regarder son passé sans complaisance. Et toutes les questions sont légitimes, notamment quand il s’agit de s’interroger sur les limites et sur les risques de la violence en politique, même quand celle-ci, comme lors de la guerre d’indépendance algérienne, est légitime et inévitable.
« Algérie, histoires à ne pas dire » est un beau film à ne pas manquer, mais qui gagne à faire l’objet de débats, quitte à ce qu’ils soient l’occasion de mettre en cause librement certains de ses choix, et, surtout, afin de lui épargner le risque de servir à conforter d’autres mythes et d’autres visions fautives de l’histoire.
Par: Gilles Manceron