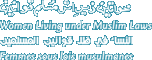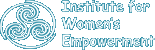France: Musulmans de France, l’histoire sous le tapis
Dans le cas de l’Islam et de l’immigration musulmane, il se répète, à certains égards, ce qui s’était joué autour des Juifs et qui avait conduit au sionisme, de Théodore Herzl notamment : ce constat, y compris de l’intérieur, que les Juifs étaient « inassimilables », justifiait la création d’un territoire en propre. La France postcoloniale, comme l’ensemble de l’Europe, ou l’ensemble du monde occidental, mais aussi comme bien des Musulmans eux-mêmes, s’interroge donc sur la nature inassimilable de l’Islam. Mais il y a derrière cette interrogation une illusion historique radicale, l’illusion que le contact avec l’Islam est récent, au mieux colonial, et que la question elle-même est des plus récentes. De manière consensuelle, en effet, nous envisageons la présence de Musulmans en France comme une conséquence de son expansion coloniale et de sa gestion de l’empire. Il n’en est rien.
Dans ce contexte colonial lui-même, l’Islam relevait de toute façon d’un impensé. Protégé, mais aussi surveillé, étroitement pris en compte dans les provinces musulmanes de l’empire, il était interdit de visibilité en métropole. Dans les colonies et en Algérie, notamment, la politique religieuse de la France se construisait dans une très grande déférence à l’égard de l’Islam et des chefs religieux (de certains d’entre eux tout au moins). La meilleure illustration de cette politique était Lyautey au Maroc, dont il est bien connu qu’il avait interdit aux non-Musulmans de pénétrer dans les mosquées, et qui avait de la même façon interdit l’affichage de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à Casablanca, lors d’une fête de 14 juillet, au prétexte qu’elle aurait été contraire à l’Islam. Cette déférence affichée recouvre donc, en réalité, une volonté marquée de séparer les territoires, d’assigner sa place à chacun, sans confusion, et de la territorialiser culturellement et religieusement. Je sais qu’on met très fortement en avant aujourd’hui les phénomènes d’hybridation liés à la colonisation, mais je pense que cette hybridation coloniale ne faisait sens que sur la base d’un séparation initiale, originaire, radicale dans le rapport colonial et que le phénomène premier à prendre en compte est celui du partage, de la séparation.
Et en effet la séparation est si radicale que, sur le territoire métropolitain, il est impensable que l’Islam soit honoré ou même simplement reconnu, à l’inverse de ce qui se passe au même moment dans le colonies à dominante musulmane. L’immigration maghrébine en France commence dès la fin du XIXe siècle, et bien souvent à l’initiative de patrons français, mais, dans ce moment, il est impensable pour la société française de concevoir ces immigrés comme des Musulmans. L’impensé est tel et si durable que même les spécialistes de ces questions, les chercheurs qui ont travaillé sur cette première immigration musulmane, ne se sont pas posé, pendant très longtemps, la question du culte, de la pratique religieuse de ces premiers migrants, ni même la question des cimetières.
On sait que la première guerre mondiale et la participation massive, notamment, d’Ouest-Africains et de Maghrébins Musulmans, ainsi que la révélation de la loyauté de ces régions de l’empire, ont entraîné une reconnaissance quasi obligée de l’Islam sur le territoire métropolitain, mais il a fallu attendre 1937 pour que soit construite la Mosquée de Paris, la première mosquée officielle en France métropolitaine, en gage de reconnaissance. En réalité, la première mosquée française avait été construite en 1905 à Saint-Denis de la Réunion, mais cette réalité va dans le même sens, et elle confirme un large consensus pour refuser l’Islam sur le territoire métropolitain. Déjà se fait jour l’idée d’une logique territoriale, l’idée que l’Islam impose sa propre logique territoriale, impose une forme de cession territoriale que nous retrouvons aujourd’hui sous la formule très vague mais percutante des « Territoires perdus de la République »
Or ce non-dit qui entoure l’Islam ne relève pas seulement d’une politique officielle. Il est très largement partagé, notamment à l’heure des luttes anti-coloniales, par les sympathisants, en France, de ces mouvements de libération. Je pense qu’aucun porteur de valise n’avait conscience d’aider des Musulmans. La charge religieuse que revêtait certains des termes clés du mouvement algérien, les termes de chahid (martyr), moujahid (combattant pour la foi, terme découlant de jihad), toutes ces résonances religieuses étaient absentes de la perception des acteurs. Les militants algériens eux-mêmes ont pu n’en avoir qu’une perception inconsciente, mais cette dimension musulmane était réelle, de même qu’un certain nombre d’entre eux s’assumaient pleinement par ailleurs comme Musulmans.
Je citerai également Pierre Bourdieu, dont les lectures de l’Algérie dans cette période, même dans leurs dimensions les plus incisives, laissent complètement de côté la question de l’Islam. Elle est à peine effleurée dans l’œuvre de Bourdieu et je pense, par exception, à sa Sociologie de l’Algérie, où il aborde la question de front. Bourdieu explique alors que, si l’Islam paraît pénétrer chaque aspect de la vie sociale dans la société algérienne, c’est parce qu’il existe une affinité structurale entre son message et le style de vie propre à la société algérienne, et que celle-ci, en quelque sorte, s’y reconnaît par affinité. Mais c’est dire, en d’autres termes, que la société algérienne préexiste à l’Islam et existerait sans lui, sans ce langage de l’Islam. Il voit d’ailleurs dans le Coran la simple justification d’un style de vie traditionnaliste, lorsqu’il discute et récuse la fameuse notion, très prégnante à cette époque, du fatalisme musulman. Mais de manière générale, si l’on se rapporte à son Esquisse d’une théorie de la pratique ou au Sens pratique, on constate que l’Islam est quasi absent. J’ai eu l’occasion par la suite de l’entendre s’expliquer sur son désintérêt pour cette question par ce constat autobiographique qu’il adhérait à une culture laïque et même anticléricale qui conduisait à ignorer ou minorer la religion musulmane.
C’était une ignorance comme a fortiori. En effet, dans ces milieux d’une gauche éclairée et progressiste, la religion en soi était perçue comme un facteur d’archaïsme, et l’Islam figurait plus que d’autres une religion arriérée, un facteur de retard, de sous-développement de la société, dont il fallait naturellement s’émanciper peu à peu. De manière plus générale, l’Islam figurait une religion de la soumission et une religion du dominé. La posture de la prière était communément raillée comme une posture de soumission, et la posture de soumission du croyant se surimposait à la soumission du colonisé. Ce n’était pas un hasard si, comme l’évoquait tragiquement Primo Lévi dans Si c’est un homme, le terme Musulman, dans les camps de concentration, en était venu à désigner les hommes vaincus, cassés, soumis. Il y a là un schème qui me paraît proprement colonial et duquel participait également l’Italie coloniale. Toute la période de l’entre-deux-guerres et même les premières décennies du XXe siècle voient se développer une culture du mépris, en France métropolitaine, autour de la figure de l’immigré, du « marchand de tapis », du pauvre hère qui se promène avec un tapis à vendre sur l’épaule. « Tapis de prière », « tapis volant », « marchand de tapis »… une vision caricaturale et dérisoire du Musulman et de toute une culture se construit autour du tapis, d’une image de l’horizontalité, de l’aplatissement, mais aussi de la clôture.
Certes, et je passe très vite sur cette question, il y a aussi une vision savante de l’Islam qui se construit, mais hors de France, hors de la France métropolitaine, et les analyses si sophistiquées du tapis que construit notamment Jacques Berque participent finalement du même postulat de la rupture culturelle. Berque en déduit l’image d’une culture hyper-cohérente, où l’art de l’artisan fait écho à la haute culture, où le motif du tapis reflète les élaborations mystiques les plus herméneutiques et élevées, mais sans que la métaphore du tissage l’amène à envisager le moindre fil tendu d’une rive à l’autre de la Méditerranée.
Alors pourquoi ce déni ? Pourquoi ce refus de voir l’Islam dans l’espace public, dès lors que l’on se situe sur le territoire métropolitain ? On a beaucoup parlé, dans la France postcoloniale, d’un « Islam des caves », dans un mélange d’indignation et de mépris (car qui est-on pour accepter de vivre ou prier dans des caves ? Il n’est guère que certains milieux chrétiens qui, par empathie, aient évoqué les premiers Chrétiens, les Chrétiens des « catacombes », et cette comparaison même renvoyait l’Islam des migrants à une illusoire nouveauté, à l’irruption secrète d’un culte jusque-là inédit.
Je crois que l’image d’un « Islam des caves » reflète bien, en réalité, l’idée d’un refoulement, au sens psychanalytique, l’idée d’une vérité cachée, repoussée sous le tapis, si j’ose dire, et bien plus refoulée encore qu’on ne le pense, quand on n’y voit qu’un fait colonial ou sa conséquence. L’Islam, en effet, était présent en France depuis le Moyen-Âge au moins, et tout au long de l’époque moderne, bien avant l’expansion coloniale, par conséquent. Ce que fut sa présence dans l’espace public, au fil de tant de siècles, nous le savons mal, et elle fut sans doute très peu visible, mais des centaines de milliers de Musulmans, nous en avons la preuve, vécurent en France et en Europe, de manière temporaire ou définitive, libres ou, dans la majorité des cas, captifs ou esclaves. L’Europe a assimilé autant de Musulmans baptisés dans le cours de son histoire que la Méditerranée musulmane a assimilé de Chrétiens, mais cette première histoire est beaucoup moins prégnante aujourd’hui, elle affleure moins à notre conscience, soit parce elle fut effectivement moins visible (on peut penser qu’un très grand nombre de Musulmans étaient baptisés, au moins formellement, et donc changeaient de nom dès qu’ils posaient le pied en terre chrétienne), soit parce que nous l’avons refoulée et que le tabou historiographique persiste.
Mais captifs et baptisés de force ou à demi forcés, est-ce qu’on cessait immédiatement d’être Musulman ? Libres, les marchands musulmans présents à Marseille ou Toulon pratiquaient-ils ouvertement l’Islam et dans quelles conditions ? Il nous est plus aisé de nous poser la question à partir du cas des galériens musulmans, par exemple, dont on sait qu’ils représentaient environ 20% des galériens. Demeurant à quai tout l’hiver, ils exerçaient comme d’autres de petits métiers dans la ville ou s’employaient dans les savonneries de Provence par exemple. La présence musulmane était donc familière dans l’espace urbain, bien avant la prise d’Alger et les premiers courant migratoires de l’époque coloniale. On sait aussi que, dès le XVIIe siècle, la question du culte et des lieux d’inhumation des Musulmans était formellement posée à Marseille ou Toulon.
Ce constat historique, si peu présent à nos consciences, et sur lequel je lance actuellement une recherche collective, nous conduit à revenir sur les opérations d’écriture de l’histoire qui sont inhérentes au fait colonial. Le mélange est premier. La violence qu’exerce l’écriture coloniale de l’histoire n’est pas seulement d’ensauvager l’Autre, de l’incarner en l’Autre, mais bien de nier aussi cette histoire commune, cette histoire tissée d’une rive à l’autre de la Méditerranée, quand bien même ces liens d’intrication ou de fusion reposent aussi sur une histoire violente, antagoniste. Concernant l’Algérie, notamment, ou le Maghreb, nous avons en tête, de manière purement fictive, une conquête sur le modèle de la Conquête de l’Amérique de Todorov, autrement dit sur le principe d’un premier contact. Il n’en est rien. Les « enfumades » de Bugeaud sont une réalité, ces hommes et ces femmes réfugiés dans des grottes et sacrifiés sont une réalité à garder en mémoire, et cette violence doit être au contraire présente à notre esprit, dans le contexte de nostalgie coloniale que nous voyons s’instaurer aujourd’hui, mais cette évocation même ne doit pas véhiculer une image trompeuse. L’image des grottes primitivise l’Algérie et elle conforte l’idée d’un choc de l’altérité, alors que le choc fut celui de la conquête, de la violence subie et non pas le choc de la découverte de l’Autre.
Ces sociétés étaient en interaction constante et même en continuum depuis l’Antiquité. Il faut donc avoir à l’esprit l’opération de rduction par laquelle l’armée française, l’État français, mettent au loin l’Algérie, l’affublent du signe de la sauvagerie, pour pouvoir s’y déployer (je rappelle brièvement que l’Expédition d’Égypte de Bonaparte, qui s’était effectuée à l’inverse dans la violence, mais sous le signe d’une reconnaissance de la culture et de la civilisation égyptiennes, avait été un échec). À titre d’illustration, j’ai en tête, sans avoir retrouvé la référence, ce texte où Assia Djebar évoque la violence symbolique par laquelle les rues d’Alger avaient été rebaptisées de noms de bêtes sauvages.
Mais pour ma part j’aimerais insister surtout sur l’amnésie fondatrice de ce rapport colonial et sur la négation qu’il implique, de toute histoire ou culture déjà partagée. Le rapport des sociétés est relancé sur une base inédite, celle de l’acculturation, et pour cette raison je récuse notamment l’héroïsation qui s’est opérée de la figure d’Abd al Kader dans ce contexte et qui est en pleine résurgence aujourd’hui. Abd al Kader, héros de la résistance anticoloniale, deviendra, comme on le sait, l’incarnation en France du noble ennemi, avant de s’attirer la plus extrême sympathie de la France pour avoir protégé, à la fin de sa vie, les chrétiens de Damas menacés par les Musulmans. On met alors en avant l’universalisme d’Abd al Kader qui adhéra à la franc-maçonnerie et qui incarne ainsi une sorte de médiateur culturel. Dans une interview récente, Abdelwahhab Meddeb va jusqu’à expliquer que l’émir adhérait à un Islam mystique déiste, immanentiste, proche de la philosophie de Spinoza, et que ce « voisinage » avec la philosophie de Spinoza l’avait aidé à « recevoir le message maçonnique » et à devenir franc-maçon. En d’autres termes, on recrée les bases d’une interaction noble et éclairée, sur la base d’un Islam qui lui même ne serait pas vraiment l’Islam ou pas l’Islam « ordinaire », mais une sorte de déisme universel. C’est une manière élitiste de rechercher ce qui, de l’Islam, est au fond « assimilable », acceptable pour l’Occident, et de conforter par contraste l’idée d’une réalité impossible à « ingérer ».
Je préfère pour ma part me souvenir de ces hommes et de ces femmes qu’Assia Djebar a évoqués notamment dans certains de ces romans. Cervantès, captif à Alger, et ce personnage de Zoraïde, qui quitte Alger et l’Islam parce qu’elle s’est secrètement convertie au christianisme ; ce personnage de Thomas d’Arcos, évoqué aussi dans Vaste est la prison, qui devient Osman à Tunis. Tous ces personnages, avérés, ont leur équivalent en Europe. Mieux encore, je crois qu’il faut dépasser la notion du destin d’exception des transfuges, celui d’un Léon l’Africain, personnage de roman pour Amin Maalouf, pour ressentir le caractère massif et anonyme de toute cette présence, libre et surtout contrainte, forcée des Musulmans en Europe avant 1830. 4 000 Musulmans recensés à Paris au XVIIIe siècle, me dit Arlette Farge.
Le verrou colonial, dans lequel la France, parmi les autres nations occidentales, joue un rôle évidemment axial, doit donc être dépassé, dénoué, à certains égards. La colonisation structure notre schéma historique et notre idée d’un contact avec l’Islam qui commencerait avec elle. Mais l’impensé de l’Islam est bien antérieur à la colonisation ; son invisibilité dans l’espace public, sa réduction à une pratique larvée et de toute façon quasi clandestine, est bien antérieure aux XIXe et XXe siècles dont nous sommes les héritiers. Pourquoi ce déni ? Pourquoi a-t-on conservé des synagogues à Bordeaux, Rouen, ou encore en Provence, alors qu’aucune mosquée ne s’élève dans le paysage urbain, ou ne suscite la mémoire urbaine ?
Je pense qu’il y a derrière ce déni de l’Islam des arguments bien plus théologiques que nous ne le pensons communément et que bien des intellectuels hostiles à l’Islam, aujourd’hui, sur la base de l’héritage des Lumières et d’une incompatibilité supposée de ces filiations (Lumières et Islam), n’ont pas conscience de ce que leur position doit, au fond, à la polémique chrétienne anti-musulmane. Dans la rhétorique polémiste antimahométane du Moyen-Âge, l’Islam est un avatar du christianisme, c’est une hérésie, c’est-à-dire une déviance interne. L’Islam est irrecevable, en effet, en tant qu’il prétend dépasser le christianisme, alors que le judaïsme illustre, à l’inverse, son propre dépassement par l’avènement du Christ. Il nous faudrait étudier de manière beaucoup plus fine la manière dont certains courants de pensée contemporains récusent le monde de l’Islam au nom de son prétendu mimétisme de l’Europe judéo-chrétienne, ou au nom de son incapacité à reproduire, précisément, les valeurs et les institutions judéo-chrétiennes (ce dernier syntagme faisant résurgence dans le débat civique français de manière récente).
Mais si je me réfère à une argumentation théologique, fût-elle inconsciente, qui serait au fond l’explication d’une hostilité si constante et radicale à l’Islam, ou d’un si fort déni, cela implique-t-il que la question coloniale devienne, dans ce cadre, secondaire ? Et cela signifie-t-il que le cadre national, la spécificité française vole en éclats ? La crise des caricatures danoises a paru le confirmer, car le Danemark n’est évidemment guère connu pour son passé colonial (excepté au Groenland). Je répondrai que cet héritage théologique ne doit pas conduire à relativiser l’héritage colonial. Tout d’abord, il est clair que seul le mépris colonial explique qu’en France, les Musulmans aient attendu si longtemps pour se voir reconnaître des droits dans l’espace civique, et notamment le droit à des conditions de culte décentes. Et encore… Officiellement, les premiers Français Musulmans à acquérir une reconnaissance comme groupe, voire comme communauté, sont les Harkis, et l’on sait à quel point ils ont été physiquement et socialement marginalisés dans la France postcoloniale, logés dans des cités écartées ou des camps de forêt…
En second lieu, l’idée que le Danemark ou l’Europe du Nord seraient exempts de tout contact « colonial » dans le cours de leur histoire, et découvriraient l’Islam avec l’immigration kurde, afghane ou marocaine contemporaines, est elle-même une illusion. Sans remonter à l’occupation normande de la Sicile, on peut se rappeler, par exemple, qu’en 1770 les Danois bombardent la ville d’Alger et que le choc est si fort que des chansons hostiles au Danois sont alors composées et qu’elle sont parvenues jusqu’à nous. Le Danemark, au XVIIIe siècle notamment, a une politique diplomatique et commerciale extrêmement conquérante dans l’ensemble de la Méditerranée musulmane. En sens inverse, des expéditions corsaires barbaresques étaient allées jusqu’en Islande, et un raid fameux de 1627 avait ramené plusieurs centaines d’Islandais au Maghreb, dont un certain nombre s’étaient convertis à l’Islam, d’autres étant rachetés et retournant dans leur Nord. Le traumatisme fut tel que des cérémonies allaturca en Islande conjuraient chaque année cet événement.
Notre illusion d’une confrontation strictement « contemporaine » est donc largement à revoir, ce soubassement de contacts, de fusions et de conflits doit être réintégré jusque dans un événement aussi improbable que l’embrasement réciproque suscité par les caricatures danoises. Et si le terme « colonial » ne doit pas faire l’objet d’un usage extensif et rétrospectif, il faut réintégrer dans nos manières de formuler aujourd’hui les rapports de l’Occident chrétien et de l’Islam toute cette histoire « enfouie sous le tapis », l’ensemble de ces dynamiques croisées où l’échange, fût-il violent, s’établit sur la base d’identités de fait coextensives l’une à l’autre. Il nous faut, d’une certaine façon, nous défaire de la réduction coloniale, mais sans jamais idéaliser le mélange colonial.
Par: Jocelyne Dakhlia (directrice d’étude à l’EHESS)
30 janvier 2008
Source: site multitude