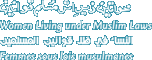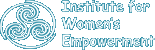Dossier 27: Réflexion sur l’introduction des lois islamiques relatives à l’individu dans le domaine public: Cas de figure observés en Tanzanie
De manière générale, l’analyse de la question féminine relève tout autant du domaine privé que du domaine public, au sein duquel quiconque, individu ou groupe, s’inscrit en tant qu’« autrui ». Il s’agit donc là d’une question d’intérêt général sujette à l’opinion publique et dans le cadre de laquelle les relations humaines sont prescrites par une forme d’autorité publique, principalement l’État. Ceci sous-entend une notion de similitude ou d’uniformité en matière de traitement ou d’application des lois entre les groupes et les individus d’une entité collective. Le domaine privé, quant à lui, est, comme son nom l’indique, soumis à une influence privée et dénuée de toute interférence publique. Porté sur l’unicité, il permet à l’individu de se distinguer de la collectivité.
Ces deux domaines sont invariablement contestés, tout particulièrement dans les contextes de pluralisme et d’intégration. Des tensions ont récemment pu être observées au sein des structures globales et nationales dans lesquelles certains groupes clamant leur individualité sur des bases religieuses, linguistiques ou ethniques [1] cherchaient à limiter l’accès universel. Tel est le fait de certains groupes islamistes affichant une incroyable capacité à revendiquer l’un ou l’autre de ces domaines selon l’opportunité politique du moment. Les nations ainsi que les communautés musulmanes font régulièrement exception à un certain nombre d’instruments de défense des droits humains au nom d’un relativisme culturel. Ils refusent toutefois de reconnaître ces mêmes droits aux non musulmans vivant à l’intérieur de leurs frontières ou aux musulmans vivant dans des contextes non musulmans. [2]
On peut observer à l’heure actuelle une tendance de plus en plus prononcée à la revendication d’une identité islamique, symboliquement représentée par l’adoption d’« écoles islamiques », de « vêtements islamiques » ou de « nourriture islamique ». Le développement de cette dite « identité islamique » ne fait qu’amplifier la contestation de l’espace privé/public. Il s’agit là d’une revendication pour la défense de l’individualisme, mais également pour la protection de l’espace permettant d’exprimer ce même individualisme, sans aucune interférence de l’État, ni contrôle public. Il cherche avant tout à privatiser le débat sur l’existence. Certains ont beau justifier une attitude aussi intransigeante comme une réponse au sentiment de vulnérabilité que ressentent les musulmans dans le contexte de mondialisation actuel et, plus récemment, face à la guerre contre le terrorisme, il n’en est pas moins une ruse politique destinée à préserver l’individuel et le privé sous le joug d’une interférence extérieure.
En effet, plusieurs moments historiques ont vu la communauté islamique revendiquer d’une façon ou d’une autre l’espace public et privé. Dans le passé, les Musulmans choisirent d’attacher moins d’importance à la sphère privée, avec le développement d’une umma, un sentiment communautaire orienté sur la collectivité. La domination coloniale a n’a fait que renforcer le patriotisme et l’identité nationale auprès de ces communautés locales. Pour préserver leur identité, les communautés islamiques colonisées revendiquèrent le droit sur l’espace privé, principalement dans le domaine des relations familiales. Est-il nécessaire de souligner que l’espace privé constitue peut-être la principale expression de l’individualisme en matière de relations humaines au sein d’une communauté globale et pluraliste.
L’application de normes disparates vient se placer au cœr des problèmes d’inégalité sociale et juridique auxquels sont confrontées les femmes. Lorsqu’il s’agit de légitimer les revendications d’un groupe quant à la défense d’une sphère privée, ces demandes sont généralement considérées comme unanimes et que leurs tenants et aboutissants seront identiques pour l’ensemble du groupe. Le relativisme culturel constitue un argument tout à fait fondé, mais ses défenseurs ne doivent pas perdre de vue les implications que peut avoir sur les différents groupes et classes sociales revendiquant le droit à un traitement distinct l’application à l’aveugle, et souvent universelle, des lois. L’équilibre entre les sphères publique et privée figure au cœr des préoccupations des femmes. Bien plus que d’affecter leur statut civil, il représente les bases sur laquelle repose leur (in)capacité à revendiquer le moindre droit, divin comme universel.
Cet article présente des cas de figure concrets illustrant certains des dilemmes auxquels sont confrontées les femmes dans les contextes pluralistes dans lesquels les principes de la Charia leur sont appliqués. Après avoir mis en perspective le débat sur les réformes sur les lois individuelles sur le territoire Tanzanien continental, il exposera trois études de cas soulignant les contradictions découlant de l’application de systèmes juridiques doubles, ainsi que les différentes mesures d’application de la justice. Les femmes et les militants des droits humains revendiquent l’égalité des sexes ; cet article, quant à lui, s’appuie sur la notion de citoyenneté pour démontrer l’incidence des violations institutionnelles dont font l’objet les droits citoyens des femmes. Il illustre notamment la façon dont le changement d’identité des femmes affecte leur statut civique d’épouses (et donc de membre d’un foyer souverain), de membres de leur communauté culturelle ou religieuse, ou de citoyennes d’une nation souveraine.
Réflexion sur la Charia et les réformes
Pourquoi se pencher sur la question de la Charia ?
L’application de la Charia a soulevé de nombreux défis en matière de droits humains dans de nombreux pays du monde musulman ainsi que dans les communautés musulmanes où elle est appliquée ou invoquée. À l’heure où de nombreux hommes et femmes revendiquent la Charia comme leur principale référence en dehors de leur conviction religieuse, il devient de plus en plus évident que le choix d’adoption de la Charia revêt un caractère de plus en plus politique. En témoignent les cas d’adultères touchant les femmes pauvres du nord du Nigéria, le refus de laisser des femmes afghanes accéder à l’éducation et au monde du travail, l’interdiction du port du voile en France et en Turquie, le harcèlement dont font l’objet les mouvements féminins, les militantes et les femmes écrivains dans différentes régions du monde musulman et l’utilisation de l’Islam par certains groupes et gouvernements en vue de revendiquer la légitimité de leurs actions et de gonfler leur influence politique.
La politisation de la Charia confond la raison humaine et la notion de justice. Les musulmans, qu’ils soient conservateurs, extrémistes ou progressistes, tentent de justifier la « solidité » de la Charia, mais sa viabilité, en pratique, tout particulièrement en ce qui concerne les problèmes liés aux femmes, soulève de grandes inquiétudes. À tel point que la Charia et son application se trouvent largement contestée par différents groupes de confession musulmane ou autre, islamistes ou modérés, religieux ou laïcs, pas tant pour ses retombées potentielles que pour ce qu’elle évoque. Alors que l’opinion publique musulmane est confrontée à l’idée d’un état islamique ou l’adoption de lois islamiques, rares sont ceux qui se soucient de son aspect pratique ou des conséquences qu’un tel système pourrait avoir sur les femmes. En fait, le discours dominant n’a pas évalué l’ampleur à laquelle les régimes existants ont suscité un idéal de justice « islamique » à la fois en termes de droits et de devoirs auprès des groupes marginalisés.
Dans cet article, j’illustrerai les principes de la Charia et sa retranscription sur la réalité en me basant sur les cas observés en Tanzanie en vue d’établir une problématique relative aux droits individuels fondamentaux et de soulever les questions morales liées aux conséquences de son application pour les femmes. La Tanzanie est dotée d’un double système juridique où lois religieuses et droit coutumier viennent complémenter le droit législatif. Contrairement à Zanzibar qui est doté au sein de son système administratif et juridique d’un système institutionnel chargé d’appliquer la loi islamique, [3] la Tanzanie continentale, qui fait l’objet de ce document, reconnaît l’application de la loi islamique aux affaires privées et sa régie par les tribunaux traditionnels, s’attirant ainsi les critiques des mouvements féminins et des islamistes. La Loi du droit matrimonial (LDM) [4] qui régit les questions matrimoniales, reconnaît trois types d’unions : civile, religieuse et coutumière. La LDM ne contient aucune provision relative à la dissolution du mariage en cas de décès et, dans un tel cas, la Loi sur la succession est applicable. [5] Nombreux sont ceux à avoir décrié une telle loi en raison de ses clauses discriminatoires. Dans beaucoup de cas, en effet, les femmes n’héritent de rien et les filles ont systématiquement droit à une part inférieure à leurs frères.
Les motivations derrière les propositions de réformes sont très variées, mais leurs instigateurs sont tous convaincus que la réforme du système législatif garantira davantage de droits aux femmes. Les mouvements militants pour les droits des femmes souhaitent voir l’établissement d’un système juridique uniforme alors que les islamistes souhaitent l’introduction de tribunaux islamiques. Le débat sur les réformes des lois personnelles prit un véritable envol suite à la Conférence de Vienne sur les droits de l’homme en 1993, mais s’est vite embourbé en raison du manque de mesures prises par l’état. Une telle attitude s’explique par un souci politique de conserver les voix musulmanes, ainsi que par une réticence à aborder les questions difficiles émanant du processus de réforme.
La subordination des femmes dans leur rôle même de citoyennes repose sur la régulation étatique. En manquant résolument de reconnaître l’indépendance des femmes en tant que citoyennes autonomes, la loi a ainsi de graves conséquences sur celles-ci. Elle condamne en effet les femmes à une vie de dépendance et d’inégalité, contribuant ainsi à la hausse de la pauvreté parmi elles et aux violences perpétrées contre ces dernières dans de nombreux domaines. L’État permet aux institutions agissant sous son égide de dicter librement la vie des femmes, mais n’offre aux femmes aucune garantie ni protection. L’application d’une législation à deux mesures s’inscrit au cœr de l’inégalité socio-juridique à laquelle sont confrontées les femmes, législation qui vient enfreindre les dispositions de la Constitution tanzanienne sur l’égalité des sexes, ainsi que la fondation éthique et morale de l’Islam qui prêche la justice et l’égalité.
Toutefois, comme je l’expliquerai plus tard, ces notions sont principalement contestées lorsqu’elles touchent aux droits des femmes dans leur vie privée. De nombreuses violations sont réalisées en toute impunité en grande partie parce que les débats sur les réformes n’ont pas encore dépassé le relativisme culturel pour se concentrer sur les considérations morales et éthiques pouvant justifier des réformes au nom de l’intérêt public. Une telle action permettra à l’État d’honorer ses obligations envers les femmes, non seulement dans le cadre des instruments nationaux et internationaux, mais, et il s’agit là d’une dimension bien plus importante, en tant que citoyennes méritant le respect et une protection contre la violation de leurs droits.
Multi-citoyenneté
Un tel système juridique double peut poser le problème de la multi-citoyenneté chez certaines femmes, situation présentant certains dilemmes, comme nous le verrons dans le cas d’une femme d’origine asiatique que j’appellerai Mama A. [6] Cette veuve et son mari s’étaient mariés tard et se trouvaient sans enfant. Le seul parent vivant de son mari était un de ses frères avec lequel il partageait une maison familiale. Les deux hommes avaient des relations très tendues et, à plusieurs reprises, ce jeune frère avait tenté de ruiner le mari de Mama A, lequel tenait un petit magasin de quartier spécialisé dans les herbes et remèdes traditionnels. Du temps où son mari était en vie, Mama A restait au foyer et laissait son mari s’occuper de ses affaires, comme il est souvent le cas chez les femmes musulmanes d’origine asiatique.
Mama A et son mari résidaient à l’arrière de leur boutique, en plein centre de la ville de Moshi. Le frère occupait l’annexe de la maison, où il avait implanté un magasin servant également de restaurant. À la mort de son mari, Mama A se retrouve couverte de dettes : la boutique connaissait un véritable déficit. C’est alors que le jeune frère décide de profiter de la vulnérabilité de Mama A pour essayer de l’expulser de la propriété qu’elle avait hérité de son mari en faisant jouer certains éléments de la police et de l’établissement religieux.
Bien qu’encore sous le régime de l’iddat, le frère commence à harceler Mama A. Il veut le magasin afin de pouvoir agrandir son commerce et pourvoir aux besoins de sa famille de plus en plus nombreuse. Aussi tente-t-il de l’expulser, par traîtrise puis par menaces pures et simples. Mais Mama A et son mari entretenaient d’excellentes relations avec la communauté africaine locale, laquelle se rend vite compte des supercheries du beau-frère. Furieuse face à l’humiliation publique qu’il lui inflige - il va jusqu’à soudoyer des policiers qui arrêteront et emprisonneront Mama A. - la communauté se tourne alors vers une organisation locale de lutte pour les droits de la femme, laquelle invoque le système judiciaire pour s’assurer que Mama A préserve ses droits.
Mama A appartient à la secte des Shi’a Ithnasheri, une communauté très fermée régie par une structure propre et des systèmes particuliers leur permettant de résoudre les litiges entre ses membres. Mama A aurait préféré que le problème soit résolu au sein de la communauté, mais leur manque d’intérêt face à sa situation l’a extrêmement découragée. Le clerc chargé de la médiation penche largement en faveur de son beau-frère [7] et fait tout pour la persuader de se plier aux désirs de celui-ci dans l’intérêt de la famille. En effet, son beau-frère, un homme d’affaires relativement aisé, contribue régulièrement aux œvres de la mosquée, aussi les chefs religieux ne veulent-ils pas l’offenser. Mama A, quant à elle, est pauvre et n’a aucune relation à Moshi. Elle peut donc être facilement sacrifiée. Plutôt que de faire sa force, selon la logique religieuse, sa vulnérabilité est devenue sa faiblesse. Le silence et l’hostilité auxquels elle est confrontée au sein de sa propre communauté la poussent à aller chercher de l’aide ailleurs.
Et pourtant, Mama A est tout à fait consciente de son dilemme. Il est fort probable qu’à son âge, elle n’ait ni la possibilité ni l’envie de se remarier. Aussi, n’aura-t-elle pas d’homme pour s’occuper d’elle. Mais elle vieillit et n’a aucune famille à Moshi ; aussi veut-elle des garanties pour son avenir. Originaire des îles, Mama A est venue s’installer à Moshi pour rejoindre son mari ; depuis sa famille a quitté Zanzibar pour Dar es Salaam en raison de la fragilité de la situation politique sur l’île. Mama A se retrouve donc dans une impasse : elle ne peut retourner sur sa terre natale, ni emménager avec ses frères dans leurs nouvelles maisons, car ils ont désormais leur propre famille. Son seul recours est de rester à Moshi et de reprendre la boutique pour subvenir à ses besoins. Or son beau-frère tente de l’expulser sous prétexte de rénover la maison aux normes municipales. Il prévoit de la loger dans une chambre dans un logis des bas quartiers mais elle craint qu’il n’honore pas sa promesse.
Une organisation d’assistance juridique s’est saisie du dossier et les tribunaux ont tranché en faveur de Mama A. Depuis, les affaires ont repris et lui ont permis de rembourser la plupart des dettes laissées par son mari. Toutefois, son madhab refuse le verdict sous prétexte qu’il a été prononcé par un organe laïc et donc non islamique. Mama A se trouve donc face à un autre dilemme : même si elle bénéficie du soutien de la communauté africaine, non musulmane pour la plupart, elle ne peut pas se permettre de se retrouver au ban de sa propre communauté. En effet, la communauté asiatique est organisée sous forme de sectes, chacune dotée d’un réseau social local parfois relié à d’autres réseaux nationaux, voire internationaux. Et elle dépend de ce réseau pour célébrer ses rites religieux et sociaux, rites prenant de plus en plus d’importance à ses yeux avec l’âge. Elle sait également que cet acte de défi pourrait non seulement lui être défavorable à Moshi, mais pourrait également affecter sa famille, bien au-delà de Moshi, risque qu’elle n’est pas prête à prendre.
Un enrichissement injuste
Le cas Marijala v Marijala illustre véritablement les complexités et les inconvénients liés à l’application des lois islamiques aux réalités quotidiennes des communautés locales. Il s’agit là d’un exemple flagrant de la façon dont les membres d’une famille profitent des lois islamiques pour s’enrichir injustement, tout en privant les héritiers légitimes de leurs droits de succession. Il illustre également la façon dont le système juridique se fait complice d’une expropriation systématique des femmes, musulmanes ou non, des propriétés familiales ou matrimoniales.
Ce cas concerne Marijala, un musulman, désormais décédé, qui ne vivait pas selon les règles islamiques. Il était employé en tant qu’ingénieur par une entreprise semi-publique. De par son travail, il vécut dans différentes régions du pays, où il entretint des relations amoureuses et sexuelles, avant de finir souvent par cohabiter avec la femme qu’il aimait. Il connut ainsi de nombreuses femmes, en épousa certaines et présenta plusieurs d’entre elles à sa famille. D’un point de vue juridique, tous ses enfants étaient issus d’unions illégitimes. À sa mort, sa famille souhaita diviser ses biens selon la loi islamique, loi qui permettrait à la mère, aux frères et sœrs de Marijala d’hériter de la part du lion, sans rien laisser de sa fortune à ses enfants et aux femmes avec lesquelles il vivait et avec lesquelles il avait fait l’acquisition de ses biens.
Deux partenaires de Marijala contestèrent cette décision en se basant sur le fait qu’elles étaient mariées à Marijala ou qu’elles avaient cohabité avec lui pendant plus de deux ans, auquel cas les dispositions de la LDM relatives à la présomption maritale seraient applicables. L’une de ces femmes était chrétienne, l’autre musulmane, mais aucune des deux n’avait de statut légal leur permettant de revendiquer une part de l’héritage puisque les tribunaux basés sur la Charia déterminèrent qu’une femme chrétienne ne pouvait hériter d’un homme musulman, même s’il s’agissait de son mari. L’argument de la femme musulmane fut également réfuté puisqu’ils s’étaient mariés sous des lois coutumières plutôt que des lois musulmanes, [8] malgré le fait que la LDM reconnaisse de telles unions.
Le tribunal se sentit contraint d’accepter l’argument de la famille et décida que les biens du défunt seraient répartis entre ses frères et sœrs. Le frère aîné fut chargé de leur administration. Bien que les enfants de Marijala n’aient rien reçu en héritage, ce même frère aîné prit quatre d’entre eux « sous sa coupe », neveux et nièces qui avaient été présentés à la famille. Des revendications soumises par deux autres femmes furent rejetées sur le principe que le défunt ne les avait pas présentées au reste de la famille. La présentation d’une femme à la famille constitue une pratique coutumière que la famille n’invoqua devant les tribunaux que lorsqu’elle plaidait en leur faveur, mais rejeta parallèlement le versement d’une dot, autre pratique coutumière communément appliquée et revendiquée par les femmes. Et pourtant, ce fût cette même pratique coutumière qui les força à s’occuper des enfants reconnus comme ayant été engendrés par le défunt.
Cette tragédie dévoilée par les tribunaux a une portée significative. Dans de telles situations, le tribunal a généralement recours à deux tests qui lui permettent de déterminer la façon dont les biens seront divisés. L’un d’entre eux consiste en l’observation du mode de vie ; or celui du défunt était loin de suivre les pratiques islamiques, mais ceci ne fut pas pris en compte dans l’examen. Seules les relations des femmes avec le défunt furent observées et donnèrent lieu à un verdict prévisible. La vie du défunt, de même que les motivations de sa famille à hériter et à gérer ses biens, firent à peine l’objet d’une enquête. En prononçant un verdict en faveur des parents du défunt, les tribunaux renversent un foyer stable et économiquement viable en les privant de ses moyens d’existence.
La réduction de la pauvreté constitue une priorité au sein du Programme de développement tanzanien et du Programme de réduction de la pauvreté. Les femmes, qui représentent une vaste majorité de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, sont particulièrement visées. Et pourtant, les structures juridiques appauvrissent davantage les femmes en permettant à d’autres individus de bénéficier de leurs biens matrimoniaux sous seul prétexte de liens familiaux et de religion. Un tel agissement vient s’inscrire dans une optique diamétralement opposée à la LDM, laquelle ne prend pas en compte notamment la légalisation d’une union. De plus, et avec l’approbation de la loi, il ignore le choix effectué par un couple sur une question privée, intrusion ayant des conséquences d’intérêt public.
Absence de représentativité et de pouvoir de décision
Les cas étudiés jusqu’à présent ont mis en lumière l’absence d’un pouvoir de décision accordé aux femmes, d’un point de vue pratique et juridique. La notion égalitaire énoncée par la constitution et la LDM se voit donc contrecarrée. [9] Ce manque est d’autant plus flagrant au sein des organisations religieuses, comme en témoigne le cas d’une victime du VIH/Sida que j’appellerai K, un exemple qui met en doute le fait que les organismes religieux accordent aux femmes un traitement plus favorable.
K était mariée à H depuis près de 20 ans. Lorsqu’ils se sont rencontrés, elle avait un bon travail et gagnait un bon salaire. Bien vite, il réussit à la convaincre de quitter son emploi et de rester à la maison, après lui avoir promis de bien s’occuper d’elle et de lui ouvrir un commerce. Mais dès le début, leur union ne fut pas des plus heureuses. H s’avéra particulièrement abusif, en actes comme en paroles, et infidèle. Quant à ses promesses de vie confortable, il ne les tint pas non plus et ne ramenait pas d’argent régulièrement à la maison. En conséquence de toutes ses aventures, il contracta le virus du VIH et le transmet à K. Une fois conscient de son état, il entreprit de se soigner, sans manquer de s’évertuer à salir la réputation de K, annonçant à qui voulait le savoir qu’elle portait la maladie.
Convaincu qu’elle ne lui servait plus à rien, il consulta l’établissement religieux afin d’obtenir un divorce, ou talâq. Ce dernier procéda à une discussion, entre hommes, du problème et légitima le talâq sans même entendre la version de K. Elle ne fut convoquée que pour entendre que son divorce avait été prononcé. Pour faciliter le départ de la femme, le tribunal islamique accorde à celle-ci près de 400 USD pour payer son voyage de retour dans sa famille et pour l’aider à s’installer. Ni la durée du mariage ni les contributions de K à la fortune familiale, tel que le stipule la LDM, ne furent pris en considération. En légitimant le talâq, les institutions religieuses avaient en fait outrepassé leurs pouvoirs. Selon la LDM, le tribunal constitue la seule autorité juridique capable de prononcer un divorce ou toute injonction relative au divorce. L’institution religieuse a pour mission de réconcilier les parties et de déterminer si le mariage est encore réparable.
Plus problématique dans ce cas est la violation évidente des règlements et des principes du fiqh en matière de résolution et de dissolution des problèmes matrimoniaux. Dans le cas de K, aucune tentative de réconciliation n’a été déployée. À aucun moment, K ou un membre de sa famille n’a été convoqué en vue de résoudre le problème ou pour prendre part aux négociations. Aucune considération ne fut faite de la contribution de K à son mariage, sous la seule présomption que son mari devait prendre soin d’elle puisqu’elle était femme au foyer. Aucune mention ne fut faite du fait qu’elle était professionnellement qualifiée et qu’elle avait été forcée par son mari à quitter son emploi, sous-entendant qu’il prendrait soin d’elle. Et problème le plus sérieux pour finir, aucune considération ne fut faite des abus et des souffrances physiques et morales endurées par K au cours de son mariage, violences infligées par un mari qui savait qu’il lui transmettait un virus mortel.
Au contraire, elle se trouve doublement punie : son mari s’appuie sur l’établissement religieux pour justifier son autorité et le droit des hommes à prononcer un divorce unilatéral. K n’ayant aucun accès aux institutions religieuses, elle se heurte à des murs dans toutes ses tentatives de défense. C’est alors qu’elle décide de faire appel à un service d’assistance juridique afin d’amener son cas devant les tribunaux. Une fois de plus, et contrairement à la loi, le tribunal de première instance décrète qu’un divorce a été prononcé conformément aux rites islamiques, que la période d’iddat s’est écoulée et qu’ainsi K n’a plus aucun droit d’épouse. Faut-il mentionner que, en raison de leur manque d’expertise relative aux questions et aux lois islamiques, les tribunaux s’appuient sur l’opinion d’entités islamiques en vue de prononcer un jugement. L’avocat de K fait appel devant un tribunal de plus grande instance dans l’espoir de renverser un verdict en effraction du code.
Dans l’entrefaite, le mari de K s’est remarié et continue à mener en toute impunité son train de vie destructeur. Le système juridico-religieux célébrant les unions vient s’établir en complice des injustices perpétrées contre K et très certainement d’autres. Même si c’est elle la victime, la vie de K reste en suspens en attente du verdict en appel. Et même si l’équipe chargée de la défense de K est très optimiste quant aux résultats que leur permettra d’obtenir ce nouveau procès, les termes de la loi déniant aux femmes tout pouvoir de décision reste inchangé. La culture politico-juridique perpétuant les inégalités et les injustices envers les femmes reste bien établie, venant ainsi contredire la notion de justice islamique et les garanties prévues par la constitution. De même, les droits citoyens de K, lui garantissant une protection sur le même pied d’égalité que les autres citoyens, sont systématiquement bafoués sans qu’il n’existe de raison juridique valable justifiant la révocation de ses droits de citoyenne.
Conclusion
Les trois cas présentés illustrent à quel point, dans le système juridique actuel, la vie des femmes dépend véritablement des caprices des hommes qui les entourent. Sans compter que leur avenir reste en suspens en raison des agissements, ou plutôt du manque d’agissement, des hommes et de l’État. En résultent des situations absolument injustes du point de vue des droits humains et en totale contradiction avec la notion islamique de l’application de la justice.
Dans chacun des cas présentés, la loi islamique a été invoquée dans l’objectif d’entraver les droits de femmes ou de les empêcher de les exercer, loi restreinte à la sphère privée mais s’étendant par là même de façon fondamentale aux sphères sociale, économique et politique. Il est clair que l’effet de tels agissements va bien au-delà de leur identité en tant que femmes musulmanes, mais en tant qu’individus et citoyennes ayant droit à une protection juridique et constitutionnelle. D’après la Charia, l’homme a une obligation envers les femmes en matière de protection et de prise en charge, devant donc subvenir à leurs besoins. S’il était rationnel au moment de la révélation des versets, peu d’hommes affichent un véritable intérêt à appliquer cet édit et échouent lamentablement en ce qui est de remplir leur devoir, comme nous le montrent les trois exemples précédents. En outre, il est clair que les relations sociales, particulièrement en ce qui concerne la mobilité et les pratiques, ont tellement changé qu’elles justifient de nouvelles interprétations et de nouvelles applications plus proches et plus en réponse aux réalités actuelles. La défense de la sphère privée en tant qu’espace inviolable revient donc à rejeter de tels développements.
Le développement, l’égalité et la justice constituent une vision universelle des droits fondamentaux auxquels les hommes et les femmes devraient avoir droit sur la base de leur citoyenneté mondiale. Les constitutions nationales incarnent l’équivalent local des droits de citoyenneté universels prévus pour tous les habitants d’un pays donné. La revendication d’un traitement particulier devient donc aussi antidémocratique qu’injuste puisqu’elle servirait à un individu particulier plutôt que de défendre l’intérêt général, contredisant ainsi à la fois le dessein des lois laïques et religieuses. À long terme, elles empêchent l’évolution des principes démocratiques en matière de négociation des relations matrimoniales.
Ces cas de figure illustrent clairement qu’en l’absence de normes et de structure législative égalitaires, les femmes musulmanes de Tanzanie ou de contextes similaires seront incapables de revendiquer et de jouir de leurs droits de citoyennes d’une nation souveraine. Même en présence de lois progressistes et égalitaires, aucune égalité des sexes au sein d’un couple ne pourra être observée en l’absence de mécanismes institutionnels à cet effet.
Remerciements
Cet article a été réimprimé avec la permission de son auteur.
Notes
- Je fais ici référence à la capacité des gouvernements à introduire une clause de réserve quant à l’application d’instruments internationaux et de clauses de qualification à la législation nationale.
- Les pays dans lesquels la Charia est en place sous une forme ou l’autre sont réticents à reconnaître les autres cultes et les besoins de leurs adhérents sur le principe qu’ils se trouvent en terre islamique, alors que les musulmans vivant en minorité et en sociétés laïques sont les premiers à revendiquer leur droit à conserver en toute impunité leurs lois et leurs pratiques islamiques.
- Principalement le tribunal de Kadhi et la fiducie de Wakf.
- Loi n° 5 passée en 1971
- L’Indian Succession Act 1865
- En Kiswahili, « Mama » est une appellation respectueuse, équivalente au « Ma’am » américain ou à « Madame » en français.
- Nous observons dans les sphères religieuses une domination et une déférence à l’égard des figures commerciales, principalement en raison de leur pouvoir financier et de leur parrainage.
- Elle ne disposait d’aucune preuve écrite du mariage ; Marijala s’était limité aux rites coutumiers requis auprès de son père.
- L’article 13(5) de la Constitution condamne toute discrimination sexuelle.