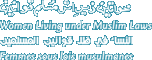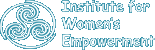Dossier 9-10: Les revues féminines en langue urdu au début du XXe siècle
Date:
décembre 1991 | Attachment | Size |
|---|---|
| Word Document | 129.16 KB |
doss9-10/f
number of pages:
232 Les premières revues de femmes indiennes, publiées en plusieurs langues, se faisant le champion de l’éducation des femmes, condamnaient les coutumes sociales qui les confinaient à une place de subordonnées, et les encourageaient à s’exprimer. Toutefois, en tant que défenseurs des droits des femmes, ces revues ont un héritage mixte. Elles présentaient la femme idéale en termes d’épouse habile et de mère nourricière, instruite mais complètement orientée vers le foyer, au service de l’homme de classe moyenne instruit. L’éducation des femmes était perçue comme un facteur favorable à cet idéal, et non comme les préparant à des carrières autres que domestiques (à part l’enseignement), ou à une existence indépendante. D’un point de vue contemporain, il est facile de voir en cet idéal de la féminité le fondement de la subordination continue des femmes au sein de la famille patriarcale. Placées dans leur contexte historique, cependant, ces revues féminines faisaient figure de pionniers braves, élargissant les frontières des rôles et de la conscience des femmes à une période où ces frontières étaient strictement limitées.
Je me propose d’étudier cet héritage mixte concernant plusieurs revues féminines en urdu, des publications que j’ai lues lors de ma recherche sur l’histoire des femmes musulmanes en Inde à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
Les revues Tahzib un-Niswan de Lahore, fondée en 1898, Khatun d’Aligarh, qui parut de 1904 à 1914, et Ismat de Delhi, fondée en 1908, ont soulevé des questions sociales importantes et permis d’éclairer et d’alléger l’isolement des femmes recluses, tout en favorisant un idéal de capacité à gérer la vie familiale. En procédant de la sorte, ces revues n’étaient pas très différentes des revues féminines fondées par les réformistes sociaux hindu en hindi, bengalais et autres langues. Les réformes sociales et patriarcales étaient symbiotiques, sans égard pour la communauté religieuse.
Tahzib un-Niswan
En 1898, Sayyid Mumtaz Ali et son épouse Muhammadi Begam, lancèrent la revue hebdomadaire Urdu, Tahzib un-Niswan, pour les femmes. Ladite revue n’était pas le premier périodique urdu féminin, mais c’était le premier à survivre. Le succès en fut éclatant, parce que lorsque le couple a commencé à le publier, il l’affranchissait sans frais à des gens dont le nom figurait sur la liste civile, dans l’espoir de recueillir des abonnements. Grand nombre des abonnés potentiels répondirent en retournant la revue à l’envoyeur, et souvent en griffonant des obscénités sur l’étiquette. Ce ne fut pas un début de bon augure. Quelques mois après, Tahzib ne comptait que 60 ou 70 abonnés, mais le couple persista, et progressivement le nombre d’abonnements s’éleva à 300 ou 400 après quatre années. La publication d’un périodique féminin était une entreprise difficile et certainement pas lucrative, et le fait que Tahzib ait survécue jusqu’aux années cinquante est dû en grande partie aux talents et aux énergies de ses fondateurs.
Mumtaz Ali (1860-1935) était issu d’une famille où l’enseignement religieux était une tradition ; son père était au service du gouvernement au Penjab. Jeune, il n’a eu qu’une année de formation au madarsa de Deobarid avant de rejoindre Lahore pour une éducation anglaise.
A Lahore, il s’intéressa à la controverse religieuse, d’abord écoutant tout simplement les débats entre missionnaires chrétiens, musulmans, et arya samajis, qui se déroulaient sur les places publiques, mais prenant part plus tard au début proprement dit. A l’âge adulte, il utilisa sa verve pour parler à ses coreligionnaires des droits féminins dans la loi islamique.
Son oeuvre, Huquq un-Niswan («les Droits des Femmes»), place l’accent sur le fait que la position des femmes dans la loi islamique était en réalité théoriquement plus élevée que celle de leur statut contemporain. Selon lui, la cause de cette différence s’explique par l’adhésion aux fausses coutumes auxquelles la force de la religion est attribuée. La clef de la réforme et de l’avancement de la communauté musulmane était, par conséquent, de combattre l’adhésion des femmes aux coutumes superstitieuses, mais aussi de remettre en question le point de vue des hommes par rapport aux droits des femmes. Les femmes sont des âmes égales devant Dieu. Donc, le fait de maintenir les femmes dans l’ignorance et l’isolement n’est pas une exigence de l’Islam, et penser que c’en est une trahit un manque de compréhension de la religion de même qu’un manque de confiance fondamental en les femmes, susceptibles d’être nuisibles à la vie familiale, à l’amour humain, et à tout ce que le message du Prophète signifiait dans une société juste et dynamique. Pour appuyer son point de vue, Mumtaz Ali soutient dans son style clair et logique bien connu : «La question est la suivante ; est-ce que la capacité de faire les choses (qui demandent la force physique) confère à l’homme une supériorité ou noblesse véritable ou donne-t-elle au sexe mâle le droit exclusif à ces qualités ? Notre réponse à cette question devrait être sans équivoque... Les deux sexes ont la noblesse, l’excellence, et tous les deux se complètent... L’âne est capable de porter sur son dos plus qu’un homme, et pourtant cela ne veut pas dire que l’âne est supérieur à l’homme. De même, l’homme ne peut pas établir sa supériorité (sur la femme) en se basant sur cet argument». Huquq un-Niswan (Lahore, 1989:7-8).
Mais comment pouvait-il mieux créer le type de changement d’attitude qu’il défendait ? Ecrire un traité savant tel que Huquq un-Niswan ne parviendrait qu’à peu de Musulmans bien instruits. La réponse, estimait Ali, est d’atteindre les femmes avec un message éclairé. Il leur fallait connaître les droits que leur donne la charia. Elles pouvaient hériter de propriété et, par conséquent, avaient besoin d’assez de savoir pour la gérer. Qui plus est, il fallait qu’elles soient imprégnées des idées contemporaines concernant l’éducation des enfants, la santé, la nutrition, la budgétisation, les règles générales, etc...
Les femmes musulmanes respectables des années 1890 ne sortaient pas en général pour s’instruire, mais pour un certain nombre de familles qui observent la réclusion l’instruction à domicile était de tradition. C’était surtout les manuels de lecture pratique qui faisaient défaut. Une femme qui ne disposait pas de lecture appropriée pouvait retomber dans l’analphabétisme. Un journal écrit dans un urdu simple, conçu en tenant compte de besoins des femmes, permettrait de faire d’elles de meilleures épouses, mères, femmes de maison et des Musulmanes plus dévouées. Les hommes instruits dont le désir d’épouses instruites émergeait à l’époque, répondraient aussi positivement à une vie familiale plus éclairée, et leurs attitudes, aussi, pourraient changer.
Mumtaz Ali était secondé par son épouse, Muhammadi Begam, dans la création de sa revue. Cette femme remarquable est généralement perçue simplement comme l’assistante de son mari, mais elle constituait une forte personnalité dans son genre. Elle était instruite à domicile, en même temps que ses nombreux frères, et quand ils fréquentèrent l’école, elle continua à apprendre quelque peu au hasard à partir de leurs manuels. Elle apprit à écrire des lettres afin de garder le contact avec sa soeur lorsque celle-ci se maria et quitta la maison. Elle organisait la maison de son père et s’occupait des plus petits enfants lorsque sa marâtre allait rendre visite à ses parents. Après son mariage, elle a continué son éducation sous la tutelle de Mumtaz Ali, même après avoir fondé leur journal. Elle servit de mère à ses deux enfants nés d’un premier mariage, organisa sa maison et finalement donna la vie à leur propre fils. Muhammadi Begam a aussi servi d’éditeur de Tahzib un-Niswan et était, en plus, l’auteur de plusieurs romans, d’un livre de cuisine, d’un manuel sur le ménage et de livres sur les règles générales. Elle mourut prématurément en 1908.
Pendant sa première décennie, sous la supervision de Muhammadi Begam, Tahzib cherchait à atteindre la femme au foyer observant la réclusion et à satisfaire ses besoins en matière de lecture et d’élargissement des connaissances. Les articles parlaient d’éducation, d’organisation de ménage, donnaient de bons conseils à la belle-fille sur la manière de s’éntendre avec sa belle-mère etc... Le thème qui revenait souvent était la réforme et la simplification des coutumes, le besoin d’éliminer les dépenses prodigues pour les rituels, la dot, les ornements. Les points de vue de Mumtaz sur les droits des femmes dans la loi islamique étaient présentés en série dans la revue.
Tahzib se classe comme un journal, donc il contenait beaucoup d’articles, d’informations sur les rencontres des femmes, ou de campagnes de mobilisation de fonds en faveur des écoles, et des résumés de discours prononcés par des femmes à l’endroit des organisations féminines. Sa présentation sous forme d’hebdomadaire permet beaucoup d’échange entre le journal et ses lecteurs, dans la rubrique «courrier des lecteurs». A titre d’exemple, une de ces lettres expliquait pourquoi les filles devraient apprendre l’anglais : «De nos jours, un grand nombre de jeunes filles sont enthousiastes à apprendre l’anglais, mais leurs parents n’apprécient pas ce fait. Ils estiment que les filles n’ont aucune raison d’apprendre l’anglais, étant donné qu’elles ne vont pas travailler hors de la maison. Ils ne se rendent pas compte que les garçons qui apprennent l’anglais aussi aimeraient avoir des épouses qui connaissent la langue. Il m’est avis que c’est la raison pour laquelle tant de femmes malheureuses restent chez elle toutes seules... En plus, si elles connaissaient l’anglais, elles pourraient contacter les hommes dans leurs bureaux en cas d’urgence...» (Tahzib un-Niswan, le 4 avril 1907:170).
Le style de cet exemple, et de celui du journal en général était simple et conversationnel. Tahzib a trouvé le juste milieu entre la présentation populaire et le contenu réformiste. Sa forme était claire et son fond était à la fois pratique et instructif.
Les derniers volumes de Tahzib reflétaient le niveau d’instruction élevé des femmes et une variété d’activités en dehors de leurs domiciles. Le style devenait quelque peu plus complexe et le vocabulaire plus riche. Les rapports et discours d’organisations féminines proliféraient. Dans un de ces rapports, Mumtaz Ali fit le commentaire suivant : «Depuis l’instauration de la Conférence des Femmes Musulmanes il y a 4 ans, nous nous y intéressons et avons toujours espéré qu’elle serait en mesure de faire quelque chose en faveur de la réforme dans la communauté. J’ai toujours pensé, cependant, que c’était prématuré... et beaucoup de gens ont pensé que je m’inscrivais en faux contre la conférence pour cette raison. Mais je n’ai que de bonnes intentions... Qu’est-ce que j’entends par la conférence est prématurée ? Je veux dire qu’il faudra abattre un travail énorme et inhabituel sinon ce sera l’échec» (TN, le 6 avril 1918:221-22).
D’autres articles révélaient que les femmes recevaient en fait l’instruction en anglais de même qu’en urdu, et le journal publiait les noms des femmes qui obtenaient leurs licences, maîtrises et diplômes en médecine avec de chaleureuses félicitations et des encouragements aux autres lecteurs à faire de même.
Les articles commencèrent à apparaître concernant la scène politique contemporaine, les événements de la première guerre mondiale, la non-coopération, et le swadeshi. Les femmes entreprirent de mobiliser des fonds pour des buts politiques : le mouvement Khilifat et le Secours turque. Dans un appel qui combinait ces causes, Nasar Sajjah Hyder, épouse de Syed Sajjad Hyder, elle-même romancière et nouvelliste urdu et la mère de la romancière urdu contemporaine, Qurratulain Hyder, insistait : «Je ne vous demande pas de donner des roupies mais... abandonnez vos vêtements étrangers et portez le swadashi uniquement... Le jour viendra où nous auront honte de sortir sans porter le khaddar. Au lieu de brûler vos vêtements étrangers, envoyez-les au Smyrna Fund (Secours Turque) pour qu’on les distribue aux femmes qui ont besoin d’habillement lourd pour l’hiver» (TN, le 28 octobre 1921:689-94).
Les lecteurs envoyaient également leurs récits de voyage et descriptions du pèlerinage des haj. La critique littéraire fit son apparition. Et nombre de jeunes femmes contributrices commencèrent à soulever les questions de la restriction de la parda (réclusion), de la polygamie et du divorce unilatéral. Vers les années 1930, les lecteurs de Tahzib avaient fait du chemin.
La revue Tahzib a surmonté l’opposition du départ et a connu le succès parce qu’elle a su répondre aux besoins sociaux exprimés. Mumtaz Ali, après tout, n’était pas le seul Musulman indien instruit à l’époque à aspirer à une vie familiale plus éclairée. Muhammadi Begam non plus n’était pas la seule femme musulmane instruite de son époque à manquer de source d’information et de moyens d’expression. Tahzib articulait une impulsion pour la réforme de la coutume, de l’observation religieuse, et de la pratique ménagère qui était principalement patriarcale. Les désirs et opinions d’hommes étaient derrière l’effort, et l’institution de la parda et de la position subordonnée des femmes dans la famille n’ont été en aucune manière remis en cause. En outre, l’insistance sur la réforme de la coutume en faveur de la religion scripturale remettait en question un royaume culturel dans lequel les femmes étaient relativement autonomes.
Toutefois, les attitudes de Mumtaz Ali, basées sur son interprétation publiée de la loi islamique, étaient remarquablement égalitaires, et son partenariat avec Muhammadi Begam était à caractère intime et créatif. L’idéal de Tahzib concernant la vie familiale peut paraître à présent caduc, mais dans les premières décennies de ce siècle, sa défense pour l’instruction féminine et l’élargissement de l’horizon créatif des femmes recluses constituaient un progrès par rapport à l’époque.
Khatun
L’autre couple actif dans le mouvement pour l’éducation des femmes et qui a fondé une revue féminine était formé par Cheikh Abdullah d’Aligarh (1874-1965) et Waheed Jahan Begam (1886-1939). Cheikh Abdullah s’était converti à l’Islam et a fréquenté le collège d’Aligarh, établi une pratique juridique dans cette ville, et épousé la sœur instruite d’un de ses camarades de classe. En 1904, le couple lança la revue mensuelle urdu Khatun en tant que journal de la Section chargée de l’Education des Femmes de la Conférence de Tous les Musulmans d’Inde sur l’Education. Cheikh Abdullah était le secrétaire de ladite section, et le but principal du journal était de plaider en faveur des écoles pour filles, surtout en faveur du projet d’Abdullah visant à créer des écoles pour filles à Aligarh.
Les Abdullahs créèrent l’Ecole des Filles d’Aligarh en 1906 et, dès 1914, ils avaient mobilisé des fonds et construit un foyer pour transformer leur école locale en pensionnat avec des élèves venant d’ailleurs.
Waheed Jahan Begam a consacré ses énergies à la gestion de l’école et à la supervision du foyer. L’école, qui s’est battue au début pour survivre, s’est développée plus tard pour devenir le Collège Féminin de l’Université Musulmane d’Aligarh.
Khatum fournit une documentation importante pour l’histoire de l’éducation des femmes musulmanes. Le Cheikh exhortait ses lecteurs à créer des associations locales pour mobiliser des fonds en vue de créer des écoles de jeunes filles. Il rendait compte des campagnes de mobilisation de fonds et de ses propres discours et rapports aux réunions annuelles de la Conférence Musulmane sur l’Education. Dans un éditorial particulièrement intéressant, présenté sous forme de dialogue entre lui-même (l’éditeur) et un partisan de l’éducation (Hami), le Cheikh demanda :
«Editeur : D’après vos déclarations, dois-je comprendre que vous êtes partisan inconditionnel de l’instruction des femmes ?
Hami : Pourquoi pas ? Quiconque s’oppose à l’éducation des femmes de nos jours est soit illettré (jahil) ou alors débile (diwana).
Editeur : Mais le fait de s’opposer à l’éducation des femmes est tout à fait différent du fait d’en être partisan... Je voulais simplement te demander si tu étais vraiment partisan de l’éducation des femmes, ou si tu fais simplement partie de ceux qui s’abstiennent de s’y opposer.
Hami : (fronçant les sourcils) Veuillez répéter votre question. Je ne pense pas l’avoir comprise.
Editeur : Janab ! J’ai simplement dit que quiconque se dit véritable partisan de l’éducation des femmes, devrait le montrer par ses actions, ses mots, ses oeuvres, etc... Et s’il avait de l’argent, il appuierait aussi ses efforts avec une donation» (Khatum, Août 1912:46-47).
Waheed Jahan faisait également des discours occasionnels ou écrivait à propos de la gestion de l’école. Dans un discours prononcé lors d’une réunion de femmes musulmanes visant à soutenir l’éducation des filles, elle fit remarquer que les femmes en Turquie et Egypte s’instruisaient et qu’elles étaient en mesure d’organiser des réunions, et que cet aspect est bénéfique à leurs sociétés ; «Lorsque les femmes se rassembleront, il y aura plus de solidarité. A présent il existe une division entre les femmes instruites et celles qui ne le sont pas. Les femmes non-instruites, qui ne sortent pas, pensent que la respectabilité se confine aux quatre murs de leurs demeures. Elles pensent que celles qui vivent en dehors de ces murs ne sont pas respectables et ne méritent pas d’être connues. Mais Dieu a destiné l’instruction tant aux hommes qu’aux femmes, pour qu’on se débarrasse de telles idées» (Khatun, Janvier 1906:7-8).
La revue contenait également beaucoup de discussions sur les questions éducationnelles, les programmes, les raisons pour ou contre l’enseignement de l’anglais aux femmes, le besoin de manuels de meilleure qualité, le besoin des étudiants d’air frais et d’exercice physique (derrière des murs élevés pour que la parda puisse être maintenue), les rapports des réunions d’associations féminines et des comités d’écoles, et des discours prononcés par des femmes, y compris la Begam de Bhopal, directrice générale de l’Ecole des Filles d’Aligarh. Faisant le compte rendu du discours de Begam avant la cérémonie inaugurale de la construction du foyer en 1914, Khatun souligna que les portes du couloir s’étaient coincées au moment où elle essayait de les ouvrir, ce qui l’a amenée à railler que cela symbolisait les obstacles auxquels l’éducation des filles musulmanes fait encore face (Khatun Février-mars 1914:35, 44-54).
Khatun présentait les points de vue des femmes dans ses colonnes mais s’adressait principalement aux membres et aux patrons de la Conférence Musulmane sur l’Education, à savoir, l’élite instruite de la communauté musulmane, composée d’hommes en grande partie. Cheikh Abdullah écrivait de façon claire et convaincante en urdu, mais il n’a pas beaucoup veillé à simplifier son style afin d’atteindre le lectorat féminin nouvellement instruit. Une exception à cette observation ne fait que confirmer la règle, pour un article merveilleusement idiomatique. A.W.J. Begam de Delhi était en contradiction flagrante avec la plupart des autres articles sur l’éducation dans la revue. «J’ai entendu beaucoup de rumeurs à propos du fait que la recherche du savoir n’est pas parvenue aux femmes musulmanes, et qu’elles ne s’intéressent pas à l’éducation de quelque façon que ce soit. Les gens font des discours aux réunions et écrivent des articles dans les journaux... Mais si on leur demande ce qu’ils ont fait pour répandre la connaissance chez les femmes... la réponse est tout simplement rien. Tout le monde dit que notre gari (train/charrette - l’ambiguité est donnée à dessein) arrivera à bon port, mais personne ne semble vouloir l’accrocher à un moteur, ou à un cheval, ou même à un boeuf et pourtant chacun regrette que la charrette soit toujours au même endroit. Si cela continue, nous n’avancerons jamais» (Khatun, Août 1904:41-44).
La raison d’être de Khatun était la promotion de l’éducation des femmes. Des informations ménagères pratiques sur l’éducation des enfants, et les modèles de broderies étaient laissé aux publications qui se rapprochaient plus du style de Thazib. Khatun a atteint ses objectifs mais, en 1914, avec l’ouverture du foyer, les Abdullah eurent beaucoup de difficultés pour gérer le pensionnat ; c’est ainsi que Khatun cessa de paraître.
Ismat
Le dernier de ce triptyque de premières revues féminines en urdu est Ismat de Delhi, fondée en 1908 par Rashidul Khairi (1868-1936) qui a connu la popularité en tant que romancier urdu. Il était le neveu d’un autre romancier urdu populaire, «Député» Nazir Ahmad (1830-1912). Rashidul Khairi, au cours de sa carrière de romancier prolifique, s’est octroyé le surnom de musuvvir-e-gham («peintre du chagrin») pour ses histoires mélodramatiques et extrêmement populaires à propos des vies tragiques des femmes opprimées. Les revenus de ses romans lui permirent de financer Ismat, un mensuel qui a été fondé d’abord à titre de journal littéraire pour encourager les femmes à écrire des essais. La revue contenait également un nombre considérable d’articles signés de Rashidul Khairi et d’autres, des articles visant à promouvoir l’éducation des femmes et la domesticité respectable si chère aux réformistes sociaux de l’époque, qu’ils soient hindu ou musulmans.
Les romans de Rashidul Khairi donnent un indice à ses attitudes vis-à-vis des femmes, leur instruction et leur édification. Une première oeuvre, Hayat-e-Saleha ou Salehat, raconte l’histoire de la fille bien-aimée d’un vieil homme qui, ayant perdu sa femme, s’est remarié. La belle-mère ignorante décide d’envoyer cette jeune fille en mariage à son va-nu-pieds de jeune frère. Etant donné que son père a accepté ce projet, la fille l’a accepté également. Elle se révèle épouse et femme exemplaire, mais elle n’est pas appréciée par son vaurien d’époux. Son père meurt par la suite, de même qu’elle. L’héroïne, Saleha, bien qu’instruite, est néanmoins utilisée par son père et par son époux, mais elle reste dévouée et résignée. Un grand nombre des héroïnes de Rashidul Khairi meurent, souvent par destruction. Elles sont alors honorées dans la mort, contrairement au moment où elles étaient en vie. On commence à comprendre pourquoi il était surnommé «le peintre du chagrin», et on sent que l’ombre de Rashidul Khairi plane sur les cinéastes de Bombay, aujourd’hui.
Les premiers numéros d’Ismat contenaient des histoires, des poèmes, plusieurs articles sur l’éducation, un sur le ménage, une description du Taj Mahal et plusieurs lettres d’encouragement. Une de ces lettres provenaient de Waheed Jahan Begam Abdullah ; un des poèmes était de Muhammadi Begam Mumtaz Ali. Le numéro contenait également une déclaration d’intention : Ismat était une revue en urdu destinée aux «femmes indiennes respectables», qui pourrait contenir des articles instructifs qui traitent de sujets scientifiques et éducationnels, de littérature, et de connaissance pratique, mais pas d’articles politiques. Il visait également à «se faire respecter» (haram Ki harmat qaéim rakhma) ou, comme le dit le proverbe anglais, «à se sentir maître chez soi», à «apporter le progrès au monde des femmes, et à «faire progresser la cause de la littérature féminine» (Ismat, juin 1908, annexe).
Si l’on associe le nom de la revue (Ismat signifie pureté ou chasteté) à sa déclaration d’intention, et si on les compare aux intrigues du roman de Khairi, on décèle une certaine cohésion de l’objectif dans ses efforts littéraires. Ismat se parait de la modestie, de l’honneur, et de la respectabilité, mais aussi de la passivité de ses lecteurs. Elle voyait les femmes comme objets d’un programme d’amélioration. La maison était devenue un «sanctuaire» (la double signification du mot haram est importante) ; il fallait apporter le progrès et la lumière aux femmes.
Un tel point de vue sur les femmes est hautement conventionnel. Il concorde avec le point de vue sur les femmes dans les romans de Khairi. Quelque soit le degré d’instruction et de compétence de ses héroïnes, elles sont toujours soumises même à l’égard des hommes qui les oppriment. Ce sont des victimes incapables de se défendre parce qu’elles se sont attachées aux idéaux principaux d’obéissance et de fidélité. Un certain nombre de femmes ont critiqué Khairi pour cet aspect de ses écrits. Dans un exemple de la première critique littéraire publiée dans Tahzib un-Niswan, une femme soulignait : «il capte les expressions idiomatiques féminines mieux que quiconque... Mais ses livres, dont les thèmes traitent du vécu quotidien ne sont pas très réalistes... (Il montre) les insuffisances et l’infériorité des femmes, mais cette image ne constitue aucune référence ou fierté. Il indique ce qui devrait être changé sans nous donner une idée de la façon de sortir de cette situation... Il n’aide en réalité personne en montrant des femmes en larmes jour et nuit» (TN, le 9 Juillet 1921:433-35).
Pour mettre fin à l’oppression des femmes, selon Rashidul Khairi, les hommes devaient revenir à de meilleurs sentiments. Par conséquent, dans les premières années d’Ismat, contrairement à Tahzib un-Niswan, il y avait peu, et encore, de discussion relative aux droits de la femme en Islam. En lieu et place, la revue contenait des articles et des histoires destinés à informer les femmes sur la façon de rendre la vie de leurs maris plus facile, le genre de problèmes qu’elles allaient rencontrer (et devaient supporter avec patience) une fois mariées et vivant chez leurs beaux-parents, etc.
Dans un article intitulé «Faire progresser nos femmes ?» Rashidul Khairi décrit ce qu’il estime être des indicateurs importants du changement. «Intéressons-nous simplement aux différences entre jadis et maintenant chez les filles et les belle-filles. De nos jours, les femmes sont conscientes que leur devoir ne se limite pas simplement à peupler le monde, mais en réalité de créer une certaine amélioration...
Il est impossible de nier le fait que les épouses d’aujourd’hui essayent d’améliorer les conditions de leurs ménages. C’est un fait important. Elles reconnaissent mieux également les doctrines de leur religion, et que l’un de ses commandements les plus importants se rapporte à la recherche du savoir» (Ismat, Octobre 1912:2-6).
Le but didactique d’Ismat était aussi clair que celui des romans de Rashidul Khairi, et ne remettait en cause ni les rôles féminins traditionnels ni l’autorité mâle. Il y avait une raison importante qui expliquait l’insistance du journal sur la respectabilité : Ismat comptait éviter le genre d’objections morales et d’attaques dont les autres journaux féminins tels que Tahzib, ont fait l’objet. Elle a réussi, dans ce sens. Le tirage d’Ismat en 1912 avait atteint 900 exemplaires, une meilleure performance que Tahzib au cours de ses quatre années de vie.
Toutefois, pour être juste avec Rashidul Khairi, l’intérêt qu’il accordait à la pureté, à l’honneur, et à la respectabilité n’était pas une façade. Sa moralité était hautement conventionnelle, mais défendre la cause de l’éducation des femmes, exhorter les femmes à s’exprimer dans les journaux, et exhorter les hommes à d’autres types de sentiments demandaient beaucoup de courage à l’époque.
Voici un passage tiré de Tamaddun, une autre de ses revues, qui constitue un exemple de ses écrits, adressés aux hommes, les exhortant à mettre fin à leur injustice vis-à-vis des femmes. Le ton est typiquement larmoyant : «L’histoire des droits féminins est navrante. Les femmes sont opprimées jour et nuit et ne trouvent aucun soulagement dans leur destin. Béni sera le moment où un esprit de sympathie (pour les femmes) se répandra (parmi les hommes) sur terre. L’enfer sera transformé en paradis et le chagrin en bonheur. Même au moment d’entrer dans leurs tombes, les époux ne reconnaissent pas l’oppression qu’ils ont faite subir à leurs femmes. L’information concernant les droits que l’Islam leur a conféré ne leur est jamais parvenue non plus». (Tamaddun, Mars 1913, cité dans Rashidul Khairi, Ismat Ki Kahani (Delhi 1936:12).
Rashidul Khairi aurait été horrifié si les femmes avaient commencé à réclamer leurs propres droits. Ce point a été confirmé en 1918 lorsque la Anjuman-e-Khawatin-e Islam, autrement connue sous le nom de Conférence de Toutes les Musulmanes de l’Inde, lors d’une réunion à Lahore, a adopté la résolution condamnant la polygamie. La résolution stipulait que : «... le genre de polygamie pratiquée par certains groupes de Musulmans est contre l’esprit du Coran et de l’Islam, et est préjudiciable à notre progrès en tant que communauté», et appelait les femmes à user de leur influence pour mettre fin à cette pratique.
Rashidul Khairi, au risque de choquer les lecteurs fidèles d’Ismat attaqua la résolution : «Nous sommes vraiment désolés que des épouses et filles de Musulmans respectables aient pu accepter une chose pareille... Personnellement, je ne suis pas partisan de la polygamie, mais faire une déclaration de ce genre au cours d’une réunion musulmane en présence de non-Musulmans (il y avait quelques Anglaises) ne crée que la haine vis-à-vis de l’Islam et comporte un effet nuisible pour les esprits des jeunes filles musulmanes. Ladite déclaration est également contraire au sens de la charia». (Ismat, Mars 1918:8).
Les femmes étaient étonnées, parce Rashidul Khairi avait exposé les méfaits de la polygamie dans plusieurs de ses romans et a défini clairement son point de vue selon lequel aucun homme ne peut être juste quand il a plus d’une épouse, dans l’esprit de l’injonction coranique. Pourtant, lorsque les femmes en personne ont abordé la question et évoqué l’esprit du Coran, contrairement à la lettre, Rashidul se rabattit sur la lettre, disant que puisque l’Islam autorisait la polygamie, il ne serait pas avantageux pour les femmes musulmanes de chercher son abolition. Un grand nombre de femmes le critiquèrent pour son incohérence, et pourtant sa position est tout à fait cohérente avec son point de vue selon lequel les hommes doivent être les réformateurs de la société et les améliorateurs des femmes et non les femmes elles-mêmes. Sa position se révèle donc intérieurement cohérente, qu’on l’accepte ou non.
Les œuvres de Rashidul Khairi débordent de sympathie pour les femmes opprimées de la communauté musulmane indienne. Il se considérait comme le défenseur des droits de la femme au sein de la tradition islamique et, parlant de son époque, il l’était certainement. Il fallait du courage pour dénoncer les maux sociaux qu’il décrivait dans ses œuvres, tels que la polygamie et le divorce unilatéral. Il fallait du talent pour le faire et simultanément pour être un des plus grands romanciers de l’histoire du roman urdu.
Le lecteur moderne peut trouver ses personnages stéréotypés, ses intrigues pleurnichardes et répétitives, et sa vue des femmes condescendante et patriarcale. Mais Rashidul était un pionnier. Il a créé sa revue pour encourager les femmes écrivains, et il y est parvenu, permettant à un grand nombre de personnes de continuer à écrire ouvertement sur des sujets qu’il aurait sûrement désapprouvés. Ismat déménagea ses locaux à Karachi en 1947 et continua à y paraître jusqu’à une date récente. Ses pages contenaient les écrits de beaucoup de grandes écrivains urdu du XXe siècle.
Conclusion
Les trois revues féminines urdu présentées dans cet article ne constituent que quelques exemples du genre, bien que Tahzib un-Niswan de même que Ismat aient de longues carrières, permettant ainsi à l’historien d’estimer les changements sociaux et d’attitudes au fil du temps. Les trois revues ont été fondées par des hommes, dont deux avec l’étroite collaboration de leurs épouses. Tous les trois défendaient l’instruction des femmes et définissaient un plus grand rayonnement des femmes en termes de leur capacité à gérer la vie de famille plutôt qu’en termes d’autonomie individuelle. Quand ils abordaient les questions religieuses, ils appuyaient le modèle scriptural plutôt que la pratique populaire et coutumière, c’est-à-dire qu’ils minimisaient les rituels féminins ou les taxaient de superstitieux.
En établissant des normes sociales pour les femmes, ces revues définissaient ces modèles en des termes que les hommes pouvaient reconnaître. Les femmes acceptaient de telles normes également, mais ce faisant elles peuvent avoir renoncé à quelque contrôle sur leur propre sphère. L’héritage de ces revues à caractère réformiste social s’avère donc ambigu. A mesure que les femmes s’instruisaient, qu’elles lisaient ces revues et qu’elles devenaient plus conscientes du monde extérieur et de ses valeurs, leur définition de ce qui est acceptable, ou respectable, devint plus étroitement contrôlée par ce que les hommes en pensent. Il a fallu plusieurs générations avant de voir l’évolution d’un modèle plus récent, toutefois ces premières revues féminines ont eu le mérite de permettre aux femmes de se faire entendre.
Reproduit de: Manushi
C/202 Lajpat Nagar 1, New Delhi 110024, Inde.
N° 48, sept.-oct. 1988, pp. 2-9.