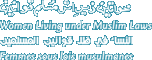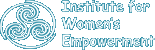Algérie: Entre mémoire et histoire - Dalila Aït El Djoudi, historienne
Nous croyons savoir que cet intérêt est lié aussi à votre environnement familial…
En effet. Est-ce un hasard, si depuis toujours, j’ai eu à mes côtés une double vision du rapport entre les deux armées ? J’ai eu la chance d’avoir un père ancien combattant, engagé dans l’armée française à l’âge de 19 ans en 1939 et démobilisé en 1945. Mon enfance a été bercée par des récits de la Seconde Guerre mondiale. Ses nombreux souvenirs étaient, tantôt liés à ce qu’on appelle la culture de guerre, tantôt à la participation à la campagne d’Italie. Ces souvenirs et blessures laissent des traces indélébiles dans la conscience d’un homme. Il me fascinait et m’émerveillait avec des récits dont il n’était pas le héros. Curieusement, mon père était beaucoup moins loquace sur les combats auxquels il avait pourtant participé directement. A la question « As-tu tué des Allemands ? », il ne répondait pas. Ou bien il éludait : « la guerre, c’est difficile ». La violence engendrée par la guerre semblait inavouable. Pourquoi ? L’évocation de ses souvenirs fut une expérience enrichissante et m’a permis de connaître l’histoire sous un autre jour, avec, de ce fait, une place privilégiée. Dès lors, la guerre m’est vite apparue comme une réalité vécue de l’intérieur par les hommes qui y ont participé.
Et pourquoi la guerre de libération?
Mon intérêt pour la guerre d’Algérie vue du côté algérien a été suscité par des récits sur la guerre mais aussi sur la vie quotidienne des combattants et militants du FLN-ALN. Ils m’ont été transmis par ma mère, militante dans l’ALN de 1955 à 1962 dans la wilaya III. Son activisme lui a valu d’être condamnée et emprisonnée en 1958-1959 dans les prisons de Seddouk, Akbou puis Béjaïa. Son engagement a été influencé par son frère, lieutenant de l’ALN, déclaré mort au champ d’honneur en avril 1961. C’est cet acquis d’une famille, « carrefour de mémoires » contradictoires, qui m’a interpellée dans ma quête d’historienne et correspond aussi à une recherche de mes racines, de mon identité. Dès lors, cette guerre apparaissait très présente par des récits, des détails de la vie au quotidien, racontés par les Algériens. A l’inverse, elle me semblait absente de la mémoire collective française, du moins au début de ma recherche. L’entretien du secret se caractérisait par des silences, des non-dits. Quelque quarante années après l’indépendance, le passé affleure à chaque instant. De ce fait, il existe une réelle continuité entre la vision d’hier et celle d’aujourd’hui. Voilà, c’est l’association de tout cela qui a suscité mon intérêt.
Votre livre croise les regards des moudjahidine et des soldats de l’armée française. En quoi échappe-t-il aux clichés?
Le but essentiel était de « recueillir » la mémoire des anciens combattants de l’ALN. Derrière ce choix, perce ma volonté d’être en contact avec ceux qui composèrent la génération des « engagés pour l’indépendance ». Pour percevoir l’image de l’autre, rien ne vaut la mémoire vive, transmise par des hommes qui revivent avec nous des années éprouvantes de leur vie. L’ALN, à la différence de l’armée française, ne regroupait pas plusieurs types de combattants. En revanche, les militaires français en Algérie présentaient des profils divers : officiers d’active, professionnels sous contrat (sous-officiers, engagés volontaires et rengagés) et hommes du contingent (officiers de réserve, sous-officiers sans contrat, appelés et rappelés). Pourtant, cette diversité ne semble pas être prise en compte dans la mémoire vive des combattants de l’ALN. Cette absence de nuances révèle un manque d’information aux échelons auxquels ils se trouvaient. Pour ne reprendre qu’un exemple de la complexité des rapports entre les deux camps, du côté français, on avait en face de soi, non des combattants, mais des « rebelles » qu’il fallait punir ou, au mieux, des « Français égarés » à remettre dans le droit chemin. Du côté algérien, on avait en face des soldats qui combattaient au sein d’une armée coloniale dans une guerre illégitime et contraire aux idéaux républicains. Ce paradoxe initial, cette non-reconnaissance de l’autre pour ce qu’il est réellement, ont été le fil rouge de mon travail.
Avez-vous rencontré des difficultés d’accès aux sources?
D’abord, il faut se poser la question du devenir des archives de l’ALN en 1962. Il semble vraisemblable que les autorités françaises déchues aient cru bon d’emporter avec elles une grande partie du patrimoine archivistique de l’époque coloniale. Une partie des documents embarqués dans les navires a certainement terminé dans les fonds de la Mare nostrum. Depuis, les autorités algériennes ne cessent de réclamer à la France ce qu’elles considèrent comme archives appartenant au patrimoine algérien. Mais, pour l’historien, la question est de savoir à quel endroit l’accès de ces archives sera le plus favorable à sa recherche. La notre n’a pu être menée sans quelques difficultés. Elles s’expliquent par la contrainte de faire un choix, nécessairement arbitraire, parmi les nombreux documents d’archives et les articles du journal El Moudjahid. La première difficulté concerne l’accès aux sources : Paris, Aix-en-Provence, Brest, Alger, la Kabylie. J’ai dû fonder ma propre méthode d’analyse pour certaines sources, originales pour les historiens, comme le cinéma et la littérature, et adopter une méthode rigoureuse propre à l’enquête orale. C’est donc sur quatre types de documents que j’ai travaillé : les archives des deux côtés, les témoignages oraux, la bibliographie d’ouvrages et d’articles et, complémentairement, les archives audiovisuelles. L’une des difficultés est d’offrir des ancrages historiques dans l’opacité consubstantielle d’une culture politique dans laquelle le secret est pensé comme « secret de fabrication » de la politique, incompatible avec le principe de la chose publique. L’objectif est de comprendre les engagements politiques et l’activisme révolutionnaire. Ce travail sur la guerre de libération nationale relève de l’histoire, de l’idéologie, du témoignage et de la mémoire et de l’historiographie de la guerre d’Algérie, notamment dans la façon dont les contemporains se la représentèrent. Mon travail n’oppose pas la mémoire et l’histoire, mais les utilise toutes les deux. Le rôle des images dans l’ensemble du traitement médiatique de la guerre d’Algérie a été aussi abordé.
Par: Slimane Aït Sidhoum
3 janvier 2008