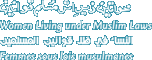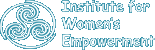France: La construction de mosquées en France, une exigence laïque?
«(…) l’Eglise recevrait ce qu’elle avait seulement le droit d’exiger, à savoir la pleine liberté de s’organiser, de vivre, de se développer selon ses règles et par ses propres moyens, sans autre restriction que le respect des lois et de l’ordre public»
-Rapport du 4 mars 1905 à la Chambre des députés, Aristide Briand.
«Aujourd’hui, plus habiles dans les termes, les nostalgiques des emprises publiques des religions baptisent la restauration de telles entreprises «laïcité ouverte», grossière expression polémique, aussi peu recevable que le serait celle de «droits de l’homme ouverts».
-La laïcité. Textes choisis et présentés par Henri Pena-Ruiz, GF Flammarion 2003.
«Frein à la mise en place d’un véritable culte islamique [1]», «source d’inégalités [2]», «caution au déséquilibre entre l’islam et les autres religions [3]»… Les critiques à l’encontre de la loi de 1905 ont ces dernières années gagné en audience autant qu’en virulence. Visant de concert l’interdiction de financement public des cultes et la propriété publique de la majorité des églises, deux principes considérés comme discriminatoires à l’égard des religions dites émergentes, les détracteurs de la loi de 1905 n’ont de cesse d’appeler à sa réforme. Selon ces derniers, l’interdiction de financement public des cultes serait en effet un archaïsme législatif dont la République devrait se défaire afin de satisfaire aux réalités contemporaines, notamment pour pallier à l’insuffisance des lieux de culte musulmans.
Or, en matière de lieux de culte, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme semble à ce jour privilégier le principe de neutralité confessionnelle de l’Etat. En effet, dans l’arrêt Manoussakis et autres contre Grèce[4], la Cour se limite à rappeler que le droit à la liberté de religion exclut toute appréciation de la part de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expressions de celles-ci. En d’autres termes, si la Cour impose aux Etats d’assurer l’égalité de traitement juridique des cultes, elle ne leur fait nullement obligation de pourvoir à l’égalité matérielle de ces derniers. Au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la laïcité demeure donc un «droit liberté», et non un «droit créance» sur le fondement duquel les associations religieuses pourraient exiger de l’Etat qu’il pourvoie à leurs besoins matériels.
De fait, en matière de régime des édifices cultuels, le droit français est exclusivement soumis à une obligation de non-discrimination. Or, il est précisément aujourd'hui reproché à la loi de 1905 de receler un caractère inégalitaire vis-à-vis de l’Islam. Pourtant, à considérer le régime de soumission les lieux de culte au droit commun de l’urbanisme qui résulte de la loi (I), il apparaît que les inégalités qui sont reprochées à cette dernière proviennent moins de lacunes juridiques que d’obstacles conjoncturels (II).
I- La loi de 1905 : une soumission des lieux de culte au droit commun de l’urbanisme
Lorsque l’on recense les griefs formulés à l’encontre de la loi de 1905, deux critiques reviennent de façon récurrente: la loi aurait favorisé les cultes établis en France avant 1905 et l’interdiction de financement public des cultes serait discriminatoire à l’égard de l’Islam. Intimement liées, ces deux critiques semblent moins se fonder sur l’incidence réelle de la loi de 1905 quant à la construction des lieux de culte (b) que sur un singulier procès intenté à l’histoire (a).
a- La critique de la séparation immobilière de l’Eglise et de l’Etat: l’histoire en procès
Soucieuse de pérenniser l’acquis révolutionnaire autant que de rationaliser le principe de laïcité - en l’émancipant notamment de ses inspirations anti-cléricales -, la loi de 1905 se devait d’être un modèle de conciliation juridique. Aussi se traduisit-elle, en matière de séparation immobilière de l’Eglise et de l’Etat, par une nationalisation des biens du clergé et l’octroi à ce dernier d’un droit d’usage des lieux de culte ainsi intégrés au domaine public.
Les détracteurs de la loi de 1905 décèlent dans ces dispositions immobilières la persistance d’une étroite relation entre les cultes et les pouvoirs publics[5], voire l’existence originelle d’une laïcité relative, qui justifierait aujourd’hui le subventionnement public des religions émergentes. Pour le dire mieux, la loi de 1905 aurait indûment favorisé l’exercice de certains cultes, et l’Etat aurait donc à charge de réparer ce «préjudice historique[6]», en soutenant financièrement les religions n’ayant pas bénéficié des «avantages» prodigués en 1905.
Cette relecture critique de la loi, outre le fait qu’elle s’embarrasse fort peu de subtilité juridique, se caractérise avant tout par une singulière méconnaissance de l’histoire.
En effet, entreprise dès 1789, la nationalisation des biens du clergé ne fut nullement conçue comme un privilège accordé à l’Eglise, loin s’en faut. Incapable de lever l’impôt et de mobiliser l’épargne auprès du Trésor public, l’Etat se devait de trouver un expédient pour assurer sa viabilité financière: l’appropriation des richesses accumulées par l’Eglise constitua le plus sûr moyen de prévenir la banqueroute. Aux antipodes d’un traitement de faveur, la nationalisation des biens du clergé fut ainsi une authentique entreprise de spoliation, qui n’avait d’autre finalité que de renflouer les caisses de l’Etat (assignats) par le transfert à la nation des titres de propriété d’un patrimoine alors évalué à près de 3 milliards de livres, soit dix fois le montant du budget annuel du royaume.
En 1905, les motivations du législateur sont d’une autre nature. Après plus d’un siècle de querelles et de tractations entre la France et le Saint Siège, il s’agit de soumettre définitivement les autorités religieuses au cadre normatif de la laïcité. Pour ce faire, la loi n’hésite pas à se faire ultimatum. Elle supprime les établissements ecclésiastiques et conditionne le transfert des titres de propriété acquis par ces derniers - après la nationalisation de 1789 et avant la promulgation de la loi de 1905 – à la constitution d’associations religieuses conformément aux statuts de cette même loi. Refusant de se plier à ces exigences normatives, considérées comme une atteinte à son organisation hiérarchique, l’Eglise catholique vit ainsi la loi du 13 avril 1908 procéder à l’incorporation au domaine public de nombres d’immeubles dont elle avait pourtant la propriété légale, si ce n’est par son défaut de constitution de personne morale conformément à la loi de 1905.
Aussi apparaît-il que les critiques adressées à la loi de 1905 en matière de séparation immobilière de l’Eglise et de l’Etat sont largement infondées, tant celle-ci a constitué pour les différentes autorités ecclésiastiques la perte d’un patrimoine foncier considérable ainsi que de nombre de privilèges.
Les plus virulents détracteurs de la loi - tout en présentant cette dernière comme une «loi de circonstance» afin d’en mieux relativiser les principes – n’hésitent pourtant pas à faire abstraction de ses motivations conjoncturelles et de sa genèse historique, considérant que cette dernière aurait quoiqu’il en soit entériné la supériorité numérique des édifices cutltuels des religions établies en France avant 1905. Raisonner de la sorte équivaut à imputer à la loi des effets qui sont le produit exclusif de l’histoire, induisant en cela l’idée pour le moins discutable que le législateur aurait pour fonction première d’abolir toute réalité historique.
Ce type d’objection est d’autant moins recevable que le principe d’interdiction de financement public des cultes, largement tempéré par le droit de l’urbanisme, se révèle être moins un vecteur d’intransigeance laïque qu’un facteur d’égalité des personnes morales au sein de la société civile.
b- L’interdiction de financement public des cultes assouplie par le droit commun de l’urbanisme
Présentée comme un obstacle majeur à l’édification de mosquées en France, l’interdiction de financement public des lieux de culte posée à l’article 2 de la loi de 1905 connaît pourtant de nombreux aménagements. En effet, en soumettant in fine la construction des édifices cultuels au droit commun de l’urbanisme, la loi de 1905 laisse à disposition des pouvoirs publics une marge de manœuvre considérable en vue d’accompagner les associations religieuses dans leurs démarches immobilières, au même titre qu’avec toute personne morale légalement constituée.
En premier lieu, les collectivités publiques peuvent - sous réserve qu’ils ne constituent pas des subventions déguisées, notamment par la fixation d’un prix anormalement bas au regard de l’évaluation du bien par les Domaines [7] - conclure avec ces associations des baux emphytéotiques, particulièrement adaptés à l’affectation d’immeubles à l’exercice du culte [8]. Etablis pour une durée comprise entre 18 et 99 ans renouvelable, ces baux emphytéotiques offrent en effet aux associations religieuses une sécurité immobilière propice à l’organisation de leur culte. De plus, la somme modique des loyers attachés à ces baux - justifiée par le fait que la construction de bâtiments ainsi que l’entretien des immeubles existants demeurent à la charge du locataire - permet aux associations religieuses de surmonter en partie les difficultés rencontrées en matière de financement de leurs projets de construction. Enfin, les baux emphytéotiques octroient au locataire certains éléments du droit de propriété indispensables à l’accueil du public dans les lieux loués, dont un droit réel d’usage et de jouissance.
Ensuite, la loi de 1905 ne s’oppose pas au financement public d’activités annexes, d’ordre culturel, social ou d’intérêt général, organisées par les associations religieuses. Eu égard à la pluralité d’activités inhérente au fonctionnement d’une mosquée, cette option présente un intérêt particulier pour les associations musulmanes. Cette possibilité d’un allègement du coût financier global de construction reste néanmoins soumis à de strictes exigences. Ainsi, les lieux concernés doivent nécessairement être ouverts au public, et non aux seuls membres d’une communauté religieuse. De plus, le partage entre les activités cultuelles et celles d’une autre nature ne doit pas souffrir la confusion, sous peine de voir la décision de financement public annulée devant les juridictions administratives.
Par ailleurs, l’article 11 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 autorise les collectivités publiques à garantir les emprunts contractés par les associations religieuses en vue de la construction d’un lieu de culte. Dans ce cas particulier, il s’agit bien évidemment pour les collectivités concernées d’estimer en amont la viabilité économique du projet immobilier des associations invoquant le bénéfice d’une telle garantie.
Enfin, l’article 19 de la loi de 1905 précise que «ne sont pas considérées comme subvention les sommes allouées pour réparation aux édifices affectés aux cultes publics, qu’ils soient ou non classés monuments historiques». De fait, les collectivités publiques ont toute licence pour contribuer financièrement aux plus onéreux travaux d’entretien des nouveaux lieux de cultes.
A travers ces diverses modalités offertes par le droit de l’urbanisme, l’interdiction de financement public des cultes apparaît ainsi n’être pas tant un vecteur d’intransigeance laïque, mais plus exactement une exigence de rationalisation des rapports économiques entre les pouvoirs publics et les cultes. Néanmoins, et ce malgré les principes vertueux de la loi de 1905 en la matière, force est de constater que cette rationalisation ne trouve pas dans la société contemporaine l’écho escompté.
II- La preéminence des obstacles conjoncturels à l’édification de mosquées
Tel que nous l’avons exposé précédemment, l’interdiction de financement public des cultes ne s’oppose pas fondamentalement à la construction de mosquées en France. Tout au plus exige-t-elle une contractualisation des rapports immobiliers entre l’Etat et les associations musulmanes. Dans l’absolu, cette exigence de transparence constitue l’une des plus sûres garanties du pluralisme religieux, en ce sens qu’elle permet de prévenir toute tentative d’emprise étatique sur une religion déterminée[9].
Cependant, les faits demeurent têtus et discréditent encore trop fréquemment cet idéal juridique. En effet, les projets d’édifications de mosquées se heurtent aujourd’hui à deux écueils conjoncturels majeurs: une politisation croissante du droit de l’urbanisme (a) à laquelle s’ajoutent les conséquences de l’atomisation du clergé musulman (b).
a/ La politisation du droit de l’urbanisme
Qu’il s’agisse de jouer à l’excès des règles de l’urbanisme ou d’abuser de leurs prérogatives en matière immobilière, certains élus locaux sont devenus maîtres dans l’art de pratiquer la discrimination en toute légalité. Cette stratégie de contournement est devenue particulièrement flagrante à travers deux pratiques récurrentes: une surenchère d’exigence administrative dans les délivrances de permis de construire et un recours abusif au droit de préemption par les autorités locales.
La délivrance des permis de construire, bien que le ministère de l’Intérieur ait eu l’occasion de préciser que celle-ci n’était soumise à d’autres exigences que «celles prévues d’une façon générale par le Code de l’urbanisme[10]», reste à ce jour largement tributaire de la bonne volonté des élus locaux. Du fait de l’inertie administrative pratiquée par les municipalités les plus rétives à l’égard de la religion musulmane, l’instruction de certains dossiers peut ainsi se prolonger pendant près d’une décennie.
Parmi le florilège de motifs invoqués, outre la mauvaise intégration aux sites et le non-respect des normes d’accessibilité, le non-respect de la réglementation du plan d’occupation des sols en matière de stationnement est ainsi fréquemment employé pour justifier le refus d’un permis de construire. Destinée à l’origine à rationaliser l’implantation d’activités de commerce ou de service, la réglementation relative aux places de stationnement des établissements destinés à accueillir du public n’a pourtant jamais eu vocation à s’appliquer avec la même rigidité à la construction de lieux de culte, du fait que ces derniers ne génèrent qu’une circulation ponctuelle et très précisément ciblée dans le temps. De fait, un aménagement de cette réglementation semble éminemment souhaitable, afin de mettre un terme à l’instrumentalisation politique de ces dernières à des fins proprement incompatibles avec le principe de neutralité confessionnelle de l’Etat.
Au nombre des pratiques discriminatoires, il faut également évoquer les multiples détournements du droit de préemption, considéré par certains élus peu scrupuleux comme un authentique droit de veto à l’édification d’une mosquée dans leur commune. Malgré l’annulation quasi-systématique de ces préemptions illégales par le Conseil d’Etat[11], nombre de maires persistent pourtant à user de cette prérogative comme d’une fin de non-recevoir aux projets immobiliers des associations musulmanes. À titre d’exemple, le maire de Nice affirmait en novembre 2005 qu’il s’opposerait à la construction d’une mosquée en centre ville en usant de son droit de préemption. Il justifiait alors sa position en affirmant que «ce n’[était] pas le moment, face aux violences urbaines et à la montée de l’islam radical, d’installer en plein coeur de Nice une terre d’islam»[12].
Nombre de mesures ont été préconisées afin de remédier à de telles dérives. Parmi celles-ci, certaines présentent le double avantage de prévenir ces détournements du droit de préemption tout en préservant la cohérence de la loi de 1905- c’est à dire sans porter ouvertement atteinte au principe d’interdiction de financement public des cultes. Ainsi, le rapport Machelon propose afin «de dissuader les communes de faire un usage abusif de leur droit de préemption, (…) de les obliger à consigner les fonds nécessaires, chaque fois qu’elles exercent une telle prérogative[13]». Si une obligation de consigner l’intégralité du prix d’achat du bien préempté paraît peu souhaitable, en ce qu’elle dénaturerait l’essence même du droit de préemption, un réajustement à la hausse du montant de la consignation[14] pourrait néanmoins constituer une mesure suffisamment dissuasive sans pour autant alourdir abusivement la procédure de préemption.
b/ Les conséquences de l’atomisation du clergé musulman
Largement dépendante de la bonne volonté des élus locaux, la construction des mosquées reste également tributaire, souvent à part égale, des rivalités existant au sein même de la communauté musulmane. Dans les plus ambitieux projets de «mosquées-cathédrales» notamment, le défaut d’homogénéité de l’«Islam de France» n’a en effet pas manqué de poser de sérieux cas de conscience républicains aux municipalités les plus investies.
L’expérience phocéenne est à ce titre particulièrement révélatrice. Solennellement annoncée en juin 2001, le projet de construction d’une Grande Mosquée à Marseille devait, selon le maire Jean-Claude Gaudin, mettre un terme à plusieurs années de polémique et d’attente[15]. Sous réserve que soit formée une association représentative de la communauté musulmane de Marseille pour gérer la mosquée, la municipalité s’engage à céder sous forme de bail emphytéotique un terrain d’une superficie totale de 8500 m2[16]. Soucieux d’assurer la légitimité de l’association, le maire souhaite que ses membres soient élus à l’unanimité. Après consultation d’une cinquantaine de personnalités musulmanes, le comité de pilotage municipal constitue une liste d’une trentaine de noms considérés comme représentatifs de la communauté musulmane de Marseille. S’estimant insuffisamment représenté, le Conseil des Imams de Marseille et ses environs suscite une polémique qui interdit tout consensus sur la composition de l’association destinée à assurer la gestion de la future mosquée. Elu à la présidence du CRCM Paca en 2003 grâce à une éphémère alliance avec l’UOIF, le leader du CIME, Mourad Zerfaoui, n’en devient que plus intransigeant et affiche des prétentions incompatibles avec le consensus nécessaire à la réalisation du projet. Cette situation inextricable se prolonge deux années durant et ne prend fin qu’avec l’arrivée à la présidence du CRCM Paca de Abderrahmane Ghoul, personnalité plus encline au dialogue que son prédécesseur. Prenant acte de ces péripéties successives, le maire revient finalement sur le critère initial de l’unanimité, acceptant ainsi que les membres de l’association attributaire de la gestion de la future mosquée soient élus à la majorité. Il s’ensuit la création, en 2005, de l’association «La Mosquée de Marseille» à qui est octroyé le bail emphytéotique initialement promis. Entre l’annonce solennelle du projet et la constitution de l’association gestionnaire de la réalisation du projet, cinq années auront ainsi été dilapidées en vaines querelles entre clercs musulmans.
A certaines variantes près, dont une subvention municipale assujettie à des conditions proprement attentatoires au libre exercice des cultes, le scénario phocéen s’est rejoué à Strasbourg. Deux projets y ont ainsi fait l’objet de multiples tractations, le projet Bouanama «porté par une sensibilité d’origine marocaine[17]» et le projet Boussouf soutenu par l’UOIF, promoteur en France d’un Islam orthodoxe, entraînant des conflits similaires à ceux qui grevèrent le projet marseillais.
Bien évidemment, ces exemples ne minorent en rien la gravité des manœuvres politiques, précédemment évoquées, dont sont aujourd’hui victimes les projets de mosquées. Néanmoins, ils mettent en exergue une réalité dont les conséquences sont trop souvent sous-estimées. En effet, il apparaît que l’absence d’homogénéité de l’Islam de France a une incidence considérable dans la réalisation des projets de mosquées. Trop fréquemment, ces derniers deviennent pour les représentants de la religion musulmane des enjeux stratégiques où les finalités partisanes prennent le pas sur les attentes de la communauté.
Or, il ne saurait être reproché aux pouvoirs publics de se garder de trancher de tels litiges, l’Etat n’ayant pas vocation à désigner les personnalités destinées à contrôler les lieux de culte musulmans. Les quelques tentatives en ce sens ont d’ailleurs été généralement perçues, et ce à juste titre, comme attentatoire au libre exercice des cultes par la communauté musulmane elle-même[18]. Cette défiance des associations musulmanes à l’égard de l’intervention des pouvoirs publics dans cette problématique indique d’ailleurs qu’il existe une concordance certaine entre la définition légale et l’interprétation musulmane du principe de laïcité : toutes deux sont attachées à la neutralité confessionnelle de l’Etat.
Aussi est-il pour le moins paradoxal de la part des associations musulmanes de solliciter les faveurs de l’Etat tout en rappelant par ailleurs ce dernier à son obligation de neutralité. Une telle contradiction relève de tentative de promotion d’une «laïcité ouverte» qui tend à présenter l’Etat comme le débiteur ponctuel des associations religieuses.
Cette propension à relativiser les implications pratiques de la laïcité n’est nouvelle et s’apparente in fine à une tentation concordataire, évoquant cette période de 1801 à 1905 où les évêques étaient nommés conjointement par le pape et l’Etat et les prêtres rémunérés sur les fonds publics. Or, c’est précisément à ce régime concordataire que la loi de 1905 mit précisément un terme, en achevant de retirer ses privilèges à l’Eglise tout en lui offrant en contrepartie une totale indépendance. Malgré certaines particularités, à commencer par les motifs d’ordre ethnique qui se greffent sur les problématiques proprement religieuses, l’Islam est aujourd’hui confronté à une épreuve similaire: il s’agit pour cette religion d’intégrer la société civile comme d’autres avant elle, en prenant acte de ce que la liberté religieuse induit nécessairement le douloureux apprentissage de l’autonomie financière.
Notes:
1- La voix du Nord, 12 et 21 novembre 1999, cité dans La République et l’Islam. Entre crainte et aveuglement. Jeanne-Hélène Kaltenbach et Michèle Tribalat, Gallimard, 2002
2- L’Islam dans la République, Rapport au Premier ministre rendu par le Haut Conseil à l’Intégration, La documentation française, p.49.
3- La laïcité dans les services publics, Rapport du groupe de travail présidé par M. André ROSSINOT, p.9.
4- Arrêt Manoussakis et autres c. Grèce du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1364, § 44
5- Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, présidée par Jean-Pierre Machelon, p.24.
6- La République et l’Islam. Entre crainte et aveuglement. Jeanne-Hélène Kaltenbach et Michèle Tribalat, Gallimard, 2002, p.119.
7- Tribunal administratif de Marseille, 17 avril 2007 : Dans le cadre du projet de construction de la grande mosquée de Marseille, le loyer prévu pour le bail d'une partie des anciens abattoirs de Marseille dans les quartiers Nord de la ville, 300 euros annuels alors que les Domaines l'avaient estimé à 4.400 euros, a été considéré par le tribunal administratif comme "une subvention". Pour ce motif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de la ville qui mettait à disposition de l'association "La mosquée de Marseille" un terrain par un bail emphytéotique de 99 ans.
8- Cent ans de laïcité, Rapport annuel du Conseil d’Etat, p.390
9- Conseil d’Etat, 15 décembre 1919, Commune de Fleury lès Lavancourt, Leb. P.1053 : Le Conseil d’Etat considère comme illégal le fait d’accorder un loyer réduit à un ministre du culte ; Conseil d’Etat, 9 octobre 1992, Commune de Saint Louis contre association Shiva Soupramien, AJDA 1992, p.817 et s.
10- Rép. quest. écrite min. int. JOAN (Q), 18 décembre 1989, p.5583.
11- Conseil d'Etat, 28 avril 2004, n° 249430.
12- Un projet de mosquée à Nice suscite l’hostilité des riverains et du maire, par Paul Barelli, Le Monde, daté du 13 novembre 2005.
13- Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, présidée par Jean-Pierre Machelon, p.30.
14- Actuellement, les communes sont tenues de consigner 15% du prix évalué par le service des domaines à la Caisse des Dépôts et Consignations.
15- Article de Michel Samson, Le Monde, 27 juin 2001
16- Le terrain des anciens abattoirs de Saint-Louis, situé dans le XVème arrondissement, sur lequel se trouve notamment un entrepôt de 2250 m2 et de 10m de haut, alors dédié aux décors de l’opéra de Marseille.
17- La mosquée de Strasbourg au miroir du droit, par Abdallah Salih al-Bokhtorî.
18- La grande mosquée enfin sur les rails, Karine Portrait, La Provence, article paru le vendredi 5 janvier 2007.
Par: Jean-Christophe Moreau
1 mai 2007